Saïd Bouamama's Blog
May 12, 2025
Palestine et Moyen-Orient : Buts officiels de guerre et buts réels
Avertissement : Le présent article devait être publié dans le numéro de mai 2025 de la revue la revue « Les Possibles » (du Conseil scientifique d’Attac France). Il a été censuré avec l’explication suivante : « Après une semaine de réflexion et de discussion au sein de l’équipe de la revue Les Possibles, nous prenons la décision de ne pas publier ton texte. Malgré les allègements de formulation auxquels tu as consenti, il demeure une approbation de ce qui s’est déroulé le 7 octobre 2023. La revue ni l’association Attac ne peuvent faire preuve de la moindre complaisance, et encore moins, accepter de cautionner de tels massacres, ce qui à coup sûr serait très mal compris. Certes, ton texte met en évidence aussi l’effroyable génocide perpétré par le gouvernement israélien. Mais la condamnation de ce dernier ne compense pas l’acceptation du premier. Face à cette tragédie générale, croire que la stratégie du Hamas était susceptible de donner une perspective au peuple palestiinien se révèle être une vue funeste puisqu’aucune solution politique n’émerge, ni même la promesse de négociations ultérieures positives.Crois bien que nous sommes meurtris de cette monstrueuse situation, et désolés de devoir prendre notre décision. Crois bien aussi que cette dernière n’entame pas notre considération et nous espérons nous retrouver en de jours meilleurs« . Sans commentaire de ma part.
Au moment de la signature du cessez-le-feu de janvier dernier, un représentant des Nations-Unies résume l’état des dégâts matériels comme suit : « L’enclave est actuellement ensevelie sous 40 à 50 millions de tonnes de décombres […] Environ 30 milliards de dollars seraient nécessaires pour reconstruire Gaza, où près de 70 % des infrastructures, 60 % des maisons et 65 % des routes ont été détruites durant la guerre de 15 mois. » Selon l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme, le nombre de bombes larguées pendant les six premiers mois de la guerre [70 000 tonnes] dépassait déjà ceux de Londres en 1940-1941 [18300 tonnes], de Hambourg en 1943 [8500] et de Dresde en 1945 [ 3900 tonnes] ». Ces quelques chiffres suffisent pour distinguer la séquence de guerre actuelle de l’ensemble de toutes celles qui l’ont précédée depuis 1948 et la création de l’État d’Israël. Ils soulignent l’objectif de modifier structurellement le rapport des forces dans la région, non seulement pour Tel Aviv mais également pour Washington.
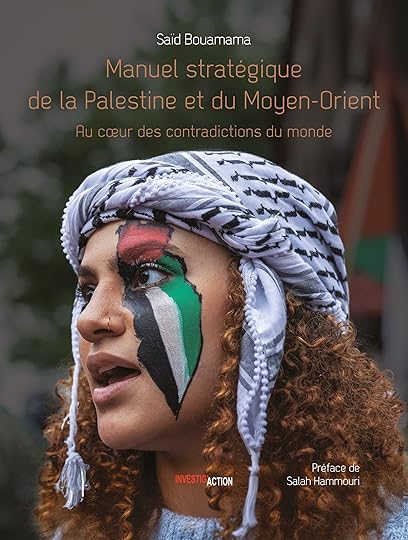
L’évolution rapide du contexte régional dans l’avant 7 octobre
Le contexte régional est en évolution particulièrement rapide avant le 7 octobre 2023. La séquence initiale de la période est une tendance offensive de longue durée des Etats-Unis et d’Israël, enclenchée avec les accords d’Oslo visant à isoler entièrement la résistance palestinienne par le biais des « accords d’Abraham ». Chacun des acteurs de ces accords poursuit ses propres objectifs en les acceptant dans une logique de réalpolitik froide et cynique. Hicham Alaoui, chercheur à Berkeley, analysait dans un texte antérieur au 7 octobre ces accords comme étant une alliance entre trois fondamentalismes, celui des évangélistes états-uniens, des fondamentalistes juifs en Israël et des « fondamentalistes étatiques » dans les pays arabes signataires des accords. Il résumait comme suit les objectifs de chacun d’entre eux avant le cataclysme du 7 octobre :
« Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, voulaient relancer une hégémonie déclinante […] Les alliés (les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc) faisaient miroiter les perspectives d’une normalisation avec Israël pour obtenir de nouveaux accords commerciaux, une assistance militaire et d’autres avantages. Le Maroc […] espérait qu’une main tendue vers Tel-Aviv allègerait les pressions exercées sur lui au sujet du Sahara occidental, avec à la clé une reconnaissance de la souveraineté de Rabat sur ce territoire. »
La dimension religieuse de l’accord n’est, selon nous, que l’enveloppe apparente, des intérêts économiques et géostratégiques en jeu dans la région. Les classes dominantes poursuivent toujours leurs intérêts en utilisant les moyens jugés les plus efficaces dans un contexte donné. Pour Washington, l’enjeu est, bien sûr, le contrôle du nœud stratégique mondial qu’est le Moyen-Orient. A l’intersection de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, cette région occupe cette place de nœud depuis plusieurs siècles et a été une préoccupation centrale de toutes les puissances coloniales puis impérialistes depuis la naissance du capitalisme en Europe. C’est cette dimension de nœud stratégique qui est la base matérielle du soutien occidental inconditionnel à Israël qu’illustre une nouvelle fois le génocide actuel. C’est également elle qui dicte les axes centraux de la stratégie états-unienne : contrecarrer la dynamique économique des BRICS et en particulier de la Chine, isoler l’Iran avant de pouvoir l’abattre, imposer Israël comme puissance régionale dominante et comme gérant local des intérêts occidentaux.
Pour mener à bien ces buts stratégiques, l’isolement de l’Iran était un impératif. Il en a découlé l’exacerbation volontaire du pseudo antagonisme shiite-sunnite. La grille de lecture religieuse, volontairement promue par Washington, permet de masquer les enjeux matériels et stratégiques réels qui sont mondiaux, en les évoquant comme étant de dimension uniquement régionale. Ils ne seraient, selon le discours dominant, politiquement et médiatiquement que le résultat d’un « impérialisme iranien » auquel résistent les États sunnites. Cette grille réductrice de lecture a justifié à partir de 2015, l’intervention militaire au Yémen de la coalition menée par l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis et le soutien des États-Unis.
Cette séquence initiale prend fin au cours de l’année 2023 qui voit le monde connaître une brusque accélération. Plusieurs facteurs se sont cumulés à partir de 2021 pour produire cette accélération sous le regard momentanément impuissant de Washington. Le premier d’entre eux est la percée économique chinoise dans la région et ses traductions diplomatiques. Le Golfe assure désormais 40 % des besoins chinois de pétrole. La sécurisation de cet approvisionnement se traduit par une activité diplomatique intense avec d’une part la signature en mars 2021 d’un accord de coopération stratégique d’une valeur de 450 milliards de dollars états-uniens et d’autre part l’organisation en décembre 2022 de trois sommets en Arabie Saoudite lors de la visite du président chinois dans ce pays : un sommet Chine-pays du Golfe, un autre Chine-Pays Arabes et enfin un sommet Chine-Arabie Saoudite.
Le second facteur est l’impasse militaire au Yémen. Cette guerre a couté plus de 100 milliards de dollars au royaume saoudien sans atteindre aucun des buts de guerre. Le troisième facteur est le « coût moral » de cette guerre considérée par les Nations-Unies comme la pire catastrophe humanitaire au monde. Le cumul de ces facteurs a conduit au cataclysme pour les États-Unis qu’a été le rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et l’Iran en mars 2023 à la suite de négociations secrètes qui se sont déroulées sous médiation chinoise. L’allié historique des États-Unis renoue les liens diplomatiques avec « l’ennemi shiite » que Washington a mis tant d’effort à construire, de surcroît sous médiation de la Chine, considéré comme « l’ennemi numéro un » depuis l’adoption par les États-Unis de la théorie du « pivot asiatique » au tournant de la décennie 2010. Une nouvelle fois était vérifié l’adage attribué à De Gaulle : « Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts ».
La signification stratégique du 7 octobre
Le contexte récent d’accélération brusque de l’histoire est incontournable pour comprendre à la fois l’offensive militaire palestinienne du 7 octobre et ses objectifs, la violence de la réaction israélienne encouragée par Washington et le rapport des forces actuel après 18 mois de génocide. C’est en effet cette mutation du contexte régional qui a conduit les organisations de résistance palestinienne à considérer, à juste titre, que la situation était propice à briser la dynamique des accords d’Abraham. Ceux-ci avaient en effet imposé un isolement de la résistance palestinienne, une colonisation accrue, la transformation de Gaza en prison à ciel ouvert pour ses deux millions d’habitants et la disparition de la question palestinienne de l’agenda politique et diplomatique mondial. L’objectif premier et le résultat du 7 octobre est bien le gel momentané de la dynamique des accords d’Abraham et le retour de la question palestinienne qui s’impose de nouveau en haut des agendas.
Cet objectif est partagé par l’ensemble des organisations de la résistance palestinienne. L’opération « déluge Al-Aqsa » du 7 octobre n’est pas seulement celle du « Hamas » comme l’ont affirmé et l’affirment encore la plupart des médias. Cinq autres organisations participèrent à cette opération militaire allant du Djihad Islamique au Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) qui se réclame du marxisme. Même si le Hamas a une importance prépondérante, nous sommes loin de la réduction dominante à une action menée par des fanatiques islamistes.
Pour parvenir à un tel résultat une opération militaire d’envergure était nécessaire. L’attaque simultanée des bases militaires israélienne du pourtour de la bande de Gaza et des villes proches de celles-ci par des commandos franchissant le mur de séparation à pied, à moto, en voiture, en camion ou en ULM, regroupe près de 3000 combattants. L’objectif de l’opération est de faire le maximum d’otages pour négocier ensuite la libération de prisonniers palestiniens. S’appuyant sur l’estimation de la sécurité sociale israélienne, la dépêche AFP du 15 décembre 2023 évalue comme suit le nombre de victimes : « Le nombre de morts de l’attaque est aujourd’hui de 695 civils israéliens, dont 36 enfants, ainsi que 373 forces de sécurité et 71 étrangers, ce qui donne un total de 1 139 hommes. » Le nombre d’otage est estimé par les autorités israélienne à 240. Ces quelques chiffres suffisent à souligner l’ampleur inédite de l’opération. Ils mettent aussi en exergue la disproportion de la riposte israélienne. L’UNICEF présente comme suit le bilan humain de cette riposte au 24 avril : 51 266 tués dont 15 613 enfants et 11200 disparus.
Un an après le 7 octobre 2024, l’historien Vincent Lemire analyse comme suit ce qu’il appelle un « tournant radical » : « Le 7 octobre est un tournant radical. Ce conflit a connu une succession de guerres interétatiques (1948, 1967 et 1973), d’intifadas (1987 et 2000), puis l’échec des accords d’Oslo (1993) et, enfin, les accords d’Abraham (2020). Le 7 octobre a mis fin au mirage des accords de paix du passé, et à cette illusion de croire que des accords commerciaux entre Israël et des régimes autoritaires arabes pourraient régler la question palestinienne. »
Le 7 octobre a eu aussi pour résultat de faire voler en éclat le roman sécuritaire israélien posant une invulnérabilité totale de l’État israélien en raison de sa supériorité technologique militaire et de services de renseignements affichés comme infaillibles. Ce roman sécuritaire a été consciemment et durablement diffusé pour produire un sentiment de sécurité quasi-total au sein de la population israélienne. En janvier dernier, la correspondante du Monde à Tel-Aviv titrait son article, « En Israël, une émigration sans précédent » en expliquant : « Des milliers d’Israéliens, parfois des familles entières, ont quitté le pays pour s’installer à l’étranger. En cause, l’insécurité et la guerre à Gaza, mais aussi la politique du gouvernement Nétanyahou et le poids de la religion dans le pays. » Le bureau central des statistiques israélien évalue en décembre 2024 ces départs comme suit pour l’année 2023 : « 82 700 personnes ont quitté Israël en 2024, tandis que 23 800 seulement y sont revenues. » Du jamais vu depuis la création de l’État d’Israël. La situation est similaire à la frontière libanaise où le sentiment d’insécurité n’a jamais été aussi important. L’idée d’une politique de dissuasion efficace par la menace permanente d’une intervention au Liban n’est plus crédible pour un nombre grandissant d’Israéliens.
De même, le discours officiel israélien sur la résistance palestinienne est largement fragilisé. Celui-ci affirmait une perte de puissance de cette résistance qui ne tenait plus que par le soutien extérieur, et en particulier celui de l’Iran. Depuis plusieurs décennies, l’axe central de la défense officiellement énoncé était la fameuse « menace iranienne », les territoires palestiniens étant considérés au mieux comme entièrement maitrisés et au pire comme maitrisables rapidement. L’opération « déluge Al-Aqsa » dément l’image d’une résistance palestinienne réduite à quelques groupuscules. Elle atteste de la capacité de cette résistance à mener des attaques de grande envergure. Enfin l’ampleur du soutien états-unien est venue souligner aux yeux de tous, l’impossible « sécurité » sans une dépendance extrême à une puissance extérieure. Certes les États-Unis n’ont jamais ménagé dans le passé l’aide économique et militaire à Tel-Aviv mais jamais dans les proportions actuelles : déploiement de navires de guerre, livraison massive d’armes, soutiens logistiques, etc.
Ces quelques facteurs indiquent que le 7 octobre a produit une modification brusque et radicale du rapport de force régional en faveur des Palestiniens. La violence de la réponse israélienne, c’est-à-dire le génocide ignoble perpétré depuis une année et demie, est incompréhensible sans la prise en compte de ce changement inattendu. Loin de n’être que le résultat d’une simple « folie » d’un Netanyahou, elle est d’abord une tentative d’inverser tout aussi radicalement le nouveau rapport de force produit par le 7 octobre.
Buts de guerre affichés et buts de guerre réels
Le génocide en cours s’est déployé à partir de trois buts de guerre affichés dès le début du carnage : « éradiquer le Hamas, libérer les otages et empêcher Gaza de demeurer une menace pour la sécurité d’Israël. » Quatre mois plus tard, il revient à la charge pour rappeler ces buts et promettre que « La victoire est à portée de main. Cela ne se compte pas en années ou en décennies, c’est une affaire de mois ». Outre le caractère contradictoire du but de la « libération des otages » et de celui « d’éradiquer le Hamas », ces buts de guerre sont impossibles à atteindre. Comme souvent dans les guerres coloniales, les militaires sont plus lucides à l’image du porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari qui déclare à la télévision le 19 juin 2024 : « Le Hamas est une idéologie, on n’élimine pas une idéologie. Dire qu’on va faire disparaître le Hamas, c’est jeter de la poudre aux yeux du public. »
L’élargissement officiel des buts de guerre le 17 septembre 2024 est tout autant irréaliste. Le communiqué de ce jour annonce comme suit cet élargissement : « le retour en toute sécurité des habitants du nord (du pays) dans leurs maisons. » Le nouveau but de guerre est précisé la même semaine sur le plan des moyens : « détruire toute la structure militaire du Hezbollah, qui s’est construite sur deux décennies. » Le chercheur et expert militaire au Centre français de recherche sur le renseignement, Olivier Dujardin, évalue comme suit le réalisme d’un tel but : « On ne détruit pas une organisation comme le Hezbollah. Même l’élimination de tous ses membres n’engendrerait pas sa disparition parce que la raison et les conditions qui président à son existence sont toujours d’actualité. Lorsque vous affrontez une organisation comme le Hezbollah, qui peut compter 50 000 ou 100 000 combattants selon les sources, et que vous décapitez des têtes, subitement vous avez affaire à une myriade de cellules qui vont mettre un certain temps à se réunifier, mais cela se produira en fin de compte […]. Les Israéliens achètent du temps pour quelques semaines ou quelques mois uniquement. »
Les buts de guerre irréalistes de Netanyahou ne signifient pas une irrationalité du premier ministre israélien. La réduction courante de Netanyahou à un dément entièrement déconnecté de la réalité n’aide en rien à comprendre la situation. Les buts de guerre irréalistes de Netanyahou ne sont, à notre sens, que des paravents visant à masquer ses véritables buts de guerre : redessiner l’ensemble de la carte régionale. Ce but central de guerre partagé depuis longtemps avec les néoconservateurs états-uniens suppose un redécoupage des frontières avec la Syrie et le Liban, une mise en dépendance totale de la Jordanie et de l’Égypte, une mise au pas de l’Iran, une déportation massive des Palestiniens et une suprématie régionale reconnue contractuellement à Israël.
É léments de bilan d’une guerre génocidaire
Un an et demi après le début d’une guerre génocidaire annoncée comme ne devant durer que « quelques mois », aucun des buts de guerre n’est atteint. Non seulement le Hamas et le Hezbollah n’ont pas été éradiqués mais Tel-Aviv a été contraint de négocier des cessez-le-feu avec eux. Cet échec stratégique ne doit cependant pas conduire à sous-estimer l’ampleur des victoires tactiques obtenues par un déploiement inédit des forces militaires dans la région, des dépenses militaires tout autant sans précédent et une violence génocidaire durable sans limite. Les coups portés tant aux forces de la résistance palestinienne et à la principale d’entre elles, le Hamas, sont sérieux. Ils affaiblissent considérablement et durablement les capacités d’action militaire de ces forces. Il en est de même au Liban avec le Hezbollah.
Depuis le 7 octobre, Netanyahou a réaffirmé Israël comme première puissance militaire régionale. Cette démonstration de force, entièrement disproportionnée au regard des forces adverses, est incompréhensible sans la prise en compte de l’ampleur des effets du 7 octobre sur la société israélienne, sur le peuple palestinien et plus largement sur l’ensemble des peuples de la région. Il s’agissait de tenter de rétablir le mythe de l’invincibilité de l’armée israélienne, même au prix d’un génocide. L’image internationale d’Israël, la vie des otages, les équilibres internes à la société politique israélienne, etc., tout a été sacrifié à cette préoccupation première de court terme. Le prix à payer est lourd. Israël n’a jamais été aussi discrédité aux yeux de l’opinion publique mondiale. La plainte pour génocide devant la Cour Internationale de Justice déposée par la République Sud-africaine a été rapidement soutenue par quinze pays. Les pays reconnaissant un Etat palestinien se multiplient à l’image de l’Espagne, de l’Irlande, de la Norvège, de la Slovénie ou de l’Arménie. Le Tribunal Pénal International émet un mandat d’arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense en novembre 2024 suite à son enquête pour crime de guerre. Ces faits soulignent que la victoire militaire se réalise au prix d’une défaite morale massive qui, elle, est de long terme.
La victoire militaire tactique d’Israël ne s’accompagne d’aucune victoire politique. Aucune distance ne s’est installée entre le peuple palestinien et ses organisations de résistance, ni entre le Hezbollah et les habitants du Sud-Liban. Une des fonctions de la violence totale de l’armée israélienne était justement de produire une telle fracture. L’image des retours de réfugiés au moment des cessez-le-feu tant à Gaza qu’au Liban atteste d’un échec complet dans ce domaine. C’est en brandissant des drapeaux du Hamas et du Hezbollah que les réfugiés rentrent chez eux se réinstaller dans des ruines. Or toute l’histoire des luttes de libération nationale atteste que les victoires militaires sans victoire politique peuvent certes affaiblir l’adversaire, mais ne peuvent pas le vaincre et encore moins l’éradiquer comme le clame Netanyahou.
Après, par exemple, les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie en 1945 qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts, le général Duval en charge de ce crime résumait comme suit la situation : «Je vous ai donné la paix pour dix ans ; si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable . » L’adolescent Kateb Yacine témoin de cette violence, explique, lui, les effets sur sa trajectoire de ce spectacle macabre : « C’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. » Les enfants et adolescents qui constituent désormais la « génération du génocide » connaîtront logiquement des effets similaires. En janvier 2025, le secrétaire d’État états-unien Anthony Blinken le constate déjà: « Sans […] un horizon politique crédible pour les Palestiniens, le Hamas – ou quelque chose d’autre aussi abject et dangereux – repoussera […], nous estimons que le Hamas a recruté presque autant de nouveaux militants qu’il en a perdus. » La situation est, bien entendu, similaire au Liban pour le Hezbollah.
Le tournant de 2025
La chute de Bachar Al-Assad puis l’arrivée de Trump au pouvoir sont deux évènements qui modifient considérablement le rapport des forces. La nouvelle configuration supprime une base arrière des résistances palestinienne et libanaise, isole encore plus l’Iran et supprime toutes les limites, même formelles, aux plans de chirurgie politique et territoriale de Netanyahou. S’estimant, à juste titre, dans une situation historique inédite depuis la Nakba, il pense pouvoir désormais assumer ses buts réels de guerre. Il ne s’agit plus d’ « éradiquer le Hamas » mais de transformer Gaza et la Cisjordanie en espaces invivables afin de susciter un exode massif. L’objectif n’est plus d’installer une administration palestinienne entièrement dépendante de Tel-Aviv mais d’accélérer considérablement la colonisation. Le but n’est plus de sécuriser les frontières sud du Liban mais d’imposer un désarmement du Hezbollah pour le moins et une transformation des frontières pour le mieux. La même logique prévaut en Syrie où l’objectif d’une présence durable est affirmé au prétexte de la mise en place d’une « zone de sécurité ».
Le discours de Donald Trump sur « Gaza-Riviera » le 4 février n’est pas un simple délire de mégalomane. Il vise à choquer par son maximalisme afin de rendre acceptable des « solutions » intermédiaires tout aussi inacceptables. Il permet de banaliser l’idée de déportation massive en orientant le débat sur les conditions de celle-ci. Les violations des cessez-le-feu en Palestine comme au Liban et l’installation durable de troupes israéliennes en Syrie inaugurent une nouvelle stratégie militaire pour les atteindre. Sans être exhaustif, abordons quelques-uns de ces axes stratégiques.
Le premier est une pression politique et diplomatique du gouvernement états-uniens sur le Liban, associée à la poursuite de bombardements israéliens pour obtenir un désarmement du Hezbollah. Compte-tenu de l’état de l’armée libanaise, un tel désarmement signifierait un Liban sans aucune capacité de défense. Le second axe est la destruction de l’ensemble des capacités militaires syriennes, malgré un nouveau gouvernement pour le moins conciliant avec Tel-Aviv. Dans la foulée, l’argument sécuritaire est mis en avant pour justifier une zone de sécurité durable. Le troisième axe est, bien entendu, l’Iran sur qui il s’agit d’exercer une pression forte pour que Téhéran se replie dans une posture uniquement défensive et d’arrêt du soutien aux résistances libanaise et palestinienne.
Concernant la Palestine, tant à Gaza qu’en Cisjordanie, le changement militaire inauguré avec la reprise de la guerre, le 18 mars, prend la forme du discours sur les « zones tampons » qui ne sont rien d’autre qu’une annexion. Les bombardements et assassinats de personnalités de la résistance, qui étaient les formes principales de l’intervention militaire depuis le 8 octobre, cèdent le pas à l’occupation pure et simple. Simultanément est poursuivie la destruction méthodique de toutes les conditions d’existence, et en particulier des infrastructures [scolaires, médicales, religieuses, etc.] dans les zones non annexées. La visée est, bien entendu, d’installer un sentiment d’impuissance, de diffuser un désarmement moral, de produire une logique de renoncement, de fabriquer un consentement à l’exil. Loin d’être aveugles, les opérations militaires israéliennes sont au contraire assises sur ces visées de démoralisation collective.
Au moment où nous terminons cet article, aucun signe de réussite de la nouvelle stratégie n’est repérable en dépit d’une vie quotidienne devenue cauchemardesque en Palestine. La prudence même avec laquelle l’armée israélienne évite tout contact militaire direct avec les villes palestiniennes indique que le Hamas est loin d’être « éradiqué ». La révolte massive espérée des Palestiniens contre les organisations de la résistance n’a pas eu lieu. Les rêves d’un accord avec les pays voisins pour qu’ils accueillent les Palestiniens sont enterrés, les gouvernements de ces pays ne pouvant pas assumer devant leur peuple la complicité avec une telle déportation. Au Liban, le Hezbollah, qui est fortement affaibli mais qui demeure la principale force militaire du pays, a rejeté totalement l’idée même d’un désarmement. Les tentatives états-uniennes d’obtenir de l’Arabie Saoudite et des Émirats une reprise de la guerre contre les Houtis ont reçu une fin de non-recevoir pour les mêmes raisons. En Iran, malgré les menaces et ultimatums de Trump, celui-ci ouvre des négociations avec Téhéran, ruinant les rêves de Netanyahou d’une guerre rapide et totale. Même le nouveau régime syrien est obligé de reculer officiellement sur ses annonces d’une signature d’accords d’Abraham avec Tel-Aviv en 2026, tant a été forte la réaction populaire.
Le panorama actuel est loin d’être celui d’une réussite stratégique israélienne. Il fait plus penser à une logique du bourbier et de l’enlisement.
Hicham Alaoui, Les accords d’Abraham, expression d’une alliance religieuse fondamentaliste, Orient XXI du 12 octobre 2023 [l’auteur précise que son analyse a été écrite avant le 7 octobre].
Seule une autre région, l’Asie du Sud-Est revêt également cette dimension de nœud stratégique mondial avec sa part de 40 % du commerce transocéanique mondial. Elle est sans surprise également un lieu d’affrontement permanent, en particulier sino-états-unien.
« Under Pressure : Houthis Target Yemeni Government with Economic Warfare », Middle East Institute, 27/02/2023
« Yémen: pire catastrophe humanitaire au monde, la sortie de crise exige un dialogue politique entre les parties, selon de hauts responsables onusiens »,
Dépêche AFP du 15-12-2023.
Unicef, Israël-Territoires palestiniens : après le cessez-le-feu, l’incertitude, consultable sur le site de l’UNICEF, https://www.unicef.fr
Vincent Lemire, Le 7 octobre est un tournant radical, La Chronique, magazine d’Amnesty International du 7-10-2024.
Isabelle Mandraud, En Israël, une émigration sans précédent, Le Monde du 28 janvier 2025.
« En Israël, une “fuite des cerveaux” massive en 2024 », Courrier International du 2 janvier 2025.
Conférence de presse de Benjamin Netanyahou, Dépêche AFP du 7 février 2024.
Dépêche AFP du 19 juin 2024.
« «Le retour des habitants du nord d’Israël, nouveau but de guerre pour Netanyahou », Communiqué du bureau du premier ministre, AFP du 17 septembre.
Ghazal Golshiri et Hélène Sallon, L’embarras de l’Iran face à l’offensive israélienne contre le Hezbollah, Le Monde du 25 septembre 2024.
« Israël rêve d’un « nouveau Moyen-Orient », mais à quelle réalité se heurtera-t-il ? », The Conversation du 29 octobre 2024.
Lettre du général Duval au gouvernement français du 16 mai 1945, cité dans Guy Pervillé, La guerre d’Algérie, PUF, Paris, 2021, p. 34.
Boucif Mekhaled, Entretien avec Kateb Yacine du 21 juillet 1984, dans Chronique d’un massacre, 8 mai 1945, Paris, Édition Syros, 1995.
Le Monde du 14 janvier 2025.
December 5, 2024
December 3, 2024
June 5, 2023
La guerre d’Algérie en France. Entretien avec Saïd Bouamama
Cet Interview est paru initialement dans le numéro 11 de la revue Solidaritat Automne/Hiver 2022
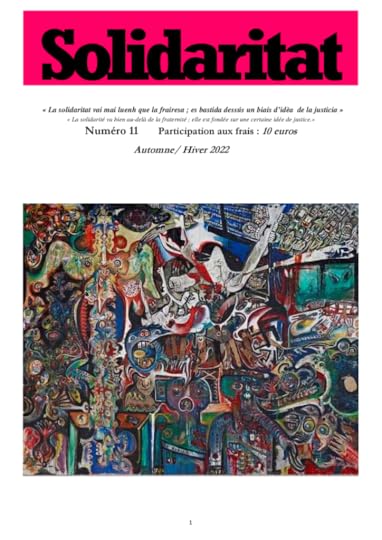
1 – À la suite des articles et entretiens que tu as bien voulus nous donner, et nous t’en remercions, nous aimerions axer cet entretien, plus particulièrement, sur la Guerre d’Algérie et ses effets à long terme. Ainsi, pourrait-on analyser le racisme qui sévit en France depuis longtemps mais qui s’est accentué ces dernières années (avec l’aide de l’État) comme l’une des conséquences de la Guerre d’Algérie, l’indépendance du peuple algérien, la fin de cette colonie, une grande défaite de l’Empire colonial français. Le racisme qui sévit en France n’étant pas, cela va de soi, uniquement causé et déterminé par son histoire coloniale. Cette question serait-elle trop simpliste, trop politique, trop sociologique ?
Le lien entre racisme et histoire coloniale est, selon moi, celui d’une interaction permanente. Il est vain de rechercher un lien de causalité unique que ce soit pour expliquer la colonisation par le racisme ou le racisme par la colonisation. Nous sommes en présence avec la double histoire du racisme français et de la colonisation de deux histoires qui se mêlent en continu, s’influencent mutuellement de manière permanente, agissent et réagissent l’une à l’autre à chaque séquence historique, se coproduisent à chaque période. Si le racisme français a existé avant la colonisation, s’est cependant celle-ci qui dès ses premiers pas lui donne un champ d’extension et une généralisation sans précédent. Le besoin de légitimer [aux yeux des français eux-mêmes comme aux yeux des indigènes coloniaux] par une hiérarchisation de l’humanité une surexploitation absolue est au cœur du processus de production du racisme colonial. C’est pourquoi l’esclave puis l’indigène colonial peuvent être considérés comme la force de travail idéale du capitalisme ascendant, celle permettant de soustraire la plus-value la plus conséquente dans l’état des forces productives de l’époque. C’est pourquoi aussi une définition possible du colonialisme est de le définir comme un processus d’exportation et de généralisation par la force brutale des rapports capitalistes.
Le racisme colonial ainsi produit ne s’arrête pas aux frontières de la colonie. Il imbibe l’ensemble des rouages de la société colonisatrice. Bien sûr la profondeur de l’imprégnation coloniale et du racisme qui lui est consubstantiel varie selon chacun de ces rouages. Il sera par exemple beaucoup plus prégnant dans les forces de l’ordre [et leur importation d’un savoir-faire répressif expérimenté à grande échelle dans les colonies] ou dans les contenus des livres scolaires ou au contraire dans leurs silences. Une telle imprégnation explique pourquoi le racisme colonial ne peut pas prendre fin avec la colonisation directe [c’est-à-dire la colonisation sous la forme d’une occupation militaire]. Le racisme colonial mute dans la séquence historique des décolonisations pour pouvoir perdurer dans ses fonctions. En devenant un racisme néocolonial centré sur une approche culturaliste [des peuples du sud, de leurs difficultés économiques, des immigrés qui en sont issus, etc.], il continue à justifier une inégalité structurelle produite par l’exploitation économique et la domination politique. En justifiant une construction pyramidale de la société française ayant à sa base le travailleur immigré, il légitime la surexploitation de celui-ci, comme jadis le racisme colonial justifiait la surexploitation de l’indigène colonial. Ces remarques déjà pertinentes pour toutes les colonisations, le sont encore plus lorsque cette colonisation était de peuplement comme pour l’Algérie. Une colonisation de peuplement impacte en effet plus profondément [par les richesses qu’elle permet, le nombre de familles concernées directement ou indirectement, etc.] la société colonisatrice.
Le racisme perdurera en conséquence tant que subsisteront ces besoins de légitimation. Il en découle plusieurs conclusions. La première conclusion est le lien entre racisme et capitalisme. Sans entrer dans le débat complexe sur l’existence ou non d’un racisme précapitaliste, il est incontestable que depuis l’apparition du capitalisme, il est suivi comme son ombre du racisme. La seconde conclusion est la nécessité de mener le combat pour la décolonisation de la société française et de ses institutions c’est-à-dire pour la débarrasser de tous les héritages [et ils sont nombreux] liés à la longue séquence coloniale. La troisième conclusion est la nécessité de relier le combat antiraciste et le combat anti-impérialiste. Tant que la France continuera à entretenir avec ses anciennes colonies des liens d’exploitation économique, elle aura besoin du racisme. Nous ne sommes pas seulement en présence d’un passé qui ne passe pas mais également en présence d’une production du présent de la société française.
2 – Comme tu l’écrivis dans le précédent numéro de Solidaritat (n°10, page 22) : Frantz Fanon a été le premier et est encore un des rares aujourd’hui à souligner que la colonisation ne faisait pas seulement des dégâts sur les peuples colonisés mais également chez les peuples des pays des États colonisateurs, pourrais-tu préciser ton propos à partir de ses arguments, au sujet, par exemple, de la bataille de Paris, du coup d’État du 13 mai 1958, de la création de l’OAS, au sujet des rapatriés, en général, et de leur longue détestation (pour certains), car dès 1962 des colons sabotent l’économie algérienne) ?
Nous faisions référence dans cette phrase à la thèse de « l’ensauvagement du colonisateur » formalisée d’abord par Aimé Césaire puis développée par Frantz Fanon. Pour Césaire en effet le nazisme n’innove pas par les techniques de violence de masses qu’il met en œuvre [camps de concentration, expérimentation médicale, expropriation violente, etc.] mais par le fait qu’il applique pour la première fois ces techniques à d’autres « blancs » alors qu’auparavant elles n’étaient utilisées que dans les colonies. De telles violences et de tels dénis de dignité ne sont possibles qu’en éliminant les victimes de notre humanité et en les projetant dans une différence absolue empêchant toute comparaison avec nous-même. C’est ce processus qui permet d’être un père de famille affectueux tout en pratiquant la torture sous l’uniforme. C’est cette logique qui permet de se considérer comme démocrate et d’être aveugle aux violences meurtrières touchant les manifestants du 17 octobre 1961. L’hypothèse d’une opinion publique ignorante des faits en 1961 n’est, selon nous pas viables, tout comme celle d’une opinion publique métropolitaine ignorante des horreurs coloniales pendant 132 ans.
L’ampleur des manifestations du 17 octobres 1961 [plusieurs dizaines de milliers], si justement dénommées « la bataille de Paris » par Jean-Luc Einaudi, le nombre de victimes [entre 200 et 300 dans l’état des savoirs actuels], celui des personnes emprisonnées [plus de 12 000], les articles de presse du lendemain qui évoquent des disparitions, des violences et des internements, etc., tous ces faits empêchent de considérer comme suffisante l’hypothèse de l’ignorance pour expliquer l’absence de réaction de l’opinion publique française à ces violences d’Etat massives et meurtrières. L’Humanité du 18 octobre écrit ainsi : « Sur ce qu’a été cette tragique journée d’hier, nous ne pouvons tout dire. La censure gaulliste est là. Et l’Humanité tient à éviter la saisie pour que ses lecteurs soient, en tout état de cause, informés de l’essentiel. » A l’autre bout de l’échiquier politique, le journal Paris-Jour du 18 octobre ne cache pas la réalité même s’il la décrit de manière particulière : « de violentes manifestations nord-africaines … C’est inouï ! Pendant trois heures 20 000 musulmans algériens ont été les maîtres absolus des rues de Paris. »
Bien sur la censure et le mensonge d’Etat empêchent de mesurer précisément l’ampleur de la violence répressive mais l’ignorance ne peut être invoquée. Beaucoup savaient et sont restés inactifs. La raison essentielle est l’état de l’opinion publique encore largement imbibée d’un racisme colonial. Les représentations sociales de l’Algérien violent, fanatique, impulsif, etc., diffusées par de multiples canaux depuis 130 ans contribuaient à déformer puissamment le regard sur la réalité. Les partis de gauche hésitent à s’opposer frontalement à cette opinion publique. Quelques mois après, le 8 février 1962, se sont des français qui sont touchés par la répression à Charonne. La mobilisation sera d’une toute autre nature : plusieurs centaines de milliers de manifestants participeront aux funérailles des victimes de Charonne alors qu’aucune manifestation publique n’a eu lieu pour celle du 17 octobre 1961.
Si nous nous sommes étendus sur la bataille de Paris, elle est loin d’être la seule concernée par cet ensauvagement du pays colonisateur. La logique est la même pour de nombreuses autres questions : la pratique de la torture quelques années à peine après l’occupation nazie, une opinion publique française acquise à la thèse de l’Algérie française jusqu’aux dernières années de la guerre d’Algérie, etc. Il faudra attendre le retour de cercueils d’appelés pour que se fissure cette opinion publique colonialiste. C’est cela que décrivent Césaire et Fanon dans la thèse de l’ensauvagement : l’acceptation de l’inacceptable et du traitement sauvage pour certains que l’on a exclu de notre humanité.
3 –Au hasard de la lecture de documents, on peut trouver, par exemple, dans un numéro spécial des Lettres françaises : Algérie 1954-1962 : la mémoire ensablée (avril 1992, page 11), ce passage, en entrefilet :… il suffit de savoir que s‘est mis en place en Algérie un système totalitaire ; encouragé par le système politique de la IVème et de la Vème République qui a profondément « cancérisé » la société française de sorte que son système politique en reste durablement atteint… N’en est-il pas de même pour le racisme, inhérent à ce système, qui conduit une partie du peuple français à l’indifférence ou à la haine ? « Cancérisé », ce néologisme de 1992, ne reste-il pas d’actualité ?
Le néologisme est particulièrement adapté à la situation coloniale et à ses effets sur le « corps social » français. Au bout d’un certain seuil de développement des cellules cancéreuse d’une tumeur primitive migrent par les canaux sanguins et lymphatiques dans d’autres parties du corps. Les métastases ainsi produites continuent leur développement indépendamment de la cellule primitive initiale. Il en est de même pour le racisme colonial. C’est bien entendu au sein même de la colonie qu’il se déploie le mieux. Tous les éléments convergent à le faire prospérer dans ce cadre colonial : les intérêts économiques des colons nécessitant un déni complet de droits des indigènes, le roman colonial adossé au roman national nécessitant une construction de l’indigène comme inférieur, la législation en vigueur scindant la population en deux catégories aux droits inégaux [les citoyens et les sujets], etc. Tel est le contexte de la tumeur raciste primitive.
Cette tumeur raciste primitive trouve ensuite de nombreux canaux pour migrer en métropole et s’y reproduire. Sans être exhaustif quelques exemples peuvent être donné. Ce fut ainsi le cas dans la mise en place de corps policiers d’exception pour les travailleurs immigrés comme la brigade nord-africaine » [de 1925 à 1945] puis la « brigade des agressions et violences » [BAV de 1953 à 1962]. Comment ne pas faire le lien avec la « BAC » ? Bien sur celle-ci n’est officiellement pas spécialisée pour une population particulière mais compte-tenu de la politique de territorialisation, elle le devient de fait pour les héritiers des anciens indigènes coloniaux. Un autre canal de transmission est constitué de la réaffectation en métropole des membres des forces de police et de gendarmerie de Tunisie et du Maroc en 1956 et d’Algérie en 1962. Ils furent orientés de manière privilégiée vers les quartiers des grandes agglomérations où résident les anciens indigènes devenus résidents étrangers. Ces policiers et gendarmes amènent avec eux des images dévalorisantes, des habitudes langagières insultantes, des pratiques humiliantes, etc. D’autres secteurs professionnels seront également à la recherche d’une force de travail « ayant l’expérience des nord-africains ». Ce fut en particulier le cas des foyers SONACOTRA dans lesquels de véritables petits « colonels » firent perdurer une ambiance coloniale jusque dans la décennie soixante-dix. Ces canaux incarnés dans des trajectoires ne sont pas les seuls. D’autres tout aussi important existent dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. Ce sont ainsi les thèses racistes de l’école psychiatrique d’Alger qui sont enseignées à tous les étudiants de métropole. Il en est de même en médecine, en criminologie, dans la formation des travailleurs sociaux, etc.
Une fois constituée la métastase poursuit d’elle-même son développement et sa croissance. Les résidents étrangers et leurs enfants français étant assignés au plus bas de la société française, la métastase issue du racisme colonial devient nécessaire pour justifier la banalisation de ce traitement inégalitaire. Comme le soulignait déjà Frantz Fanon en 1956 : « Il n’est pas possible d’asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Le racisme n’est que l’explication émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle de cette infériorisation. »
Pour poursuivre l’analogie avec le cancer, rappelons qu’une tumeur cancéreuse ne disparaît jamais d’elle-même : soit elle est combattue par divers moyens (chimio, radiothérapie, etc.), soit elle est enlevée par chirurgie. Force est de constater que concernant la tumeur raciste, rien n’a été fait après les indépendances pour l’éradiquer. L’attitude dominante fut le silence assourdissant sur la période coloniale accompagnée d’une nostAlgérie pour une minorité revendiquant fortement une fierté pour « l’œuvre civilisatrice » accomplie. Ce silence pesant est, selon nous, un des facteurs de reproduction de la tumeur raciste. La colonisation est bien productrice d’un cancer raciste faisant des métastases en métropole jusqu’à aujourd’hui.
4 – À propos de la réflexion citée ci-dessus, avions-nous à ce point envisager, en 1992, le retour du fascisme français, et surtout son ampleur (comme le montre la fin de la présentation de la couverture de ce numéro, où l’on voit l’OAS se consacrait elle-même, en juillet à Perpignan puis à l’Assemblée nationale sans guère d’opposition et dans un environnement où le gouvernement mène rondement son racisme d’État ?
Ce qui s’est passé à Perpignan cet été avec la nomination de « citoyens d’honneur de la ville » du parachutiste tortionnaire Denoix de Saint-Marc et des généraux de l’OAS Zeller et Jouhaux [fomentateurs du putsch militaire de 1961] n’est pas anecdotique. Cet évènement rappelle que c’est sur le terreau de la mentalité raciste coloniale que se sont recyclées les forces fascistes après la seconde guerre mondiale. En France ce n’est pas en se revendiquant explicitement de l’idéologie fasciste que s’est déployé le recyclage mais en réinvestissant l’imaginaire et l’inconscient collectif issus de la colonisation. Le fascisme français est, on le voit étroitement en lien avec l’histoire coloniale. C’est pourquoi les décisions successives d’amnisties des militants de l’OAS ont été vécues par le courant fasciste comme un encouragement à assumer plus explicitement leur héritage fasciste. Rappelant que dès décembre 1964 c’est-à-dire à peine deux ans après la guerre d’Algérie une première loi d’amnisties de militants de l’OAS est votée. Elle sera suivie de trois autres, en 1966, 1968 et 1982. La dernière en 1982 prétend en finir avec les « séquelles des évènements d’Algérie » et se concrétise par la réintégration des généraux putschistes [Raoul Salan, Edmond Jouhaud, Pierre-Marie Bigot, Jacques Faure, Marie-Michel Gouraud, Gustave Mentré, Jean-Louis Nicot et André Petit] dans le cadre de la réserve. Devant la forte opposition parlementaire, Mitterrand n’hésite pas à utiliser le 49.3 pour faire passer en force cette amnistie de gradés fascistes.
Le fascisme n’est pas et n’a jamais été un phénomène survenant brusquement. Il est le résultat d’un processus s’étendant sur plusieurs décennies [que nous nommons fascisation] qui voit se banaliser des discours et des mesures auparavant inimaginables sans susciter la révolte populaire. La reprise par des membres de l’appareil d’Etat, par des journalistes, par des ministres et par le président de la république de questions, de raisonnements, de mots et d’expressions, auparavant cantonnés à l’extrême-droite est un indicateur d’un processus de fascisation déjà bien enclenché. La banalisation récente dans les médias et le débat électoral de l’expression et de la thèse du « grand-remplacement » est ainsi le signe des progrès de l’offensive fascisante. Elle est le signe qu’une partie de la classe dominante inquiète pour son avenir n’hésite plus à tourner son regard vers le projet fasciste.
Les trois séquences antérieures de fascisation qu’a connu la France [à la fin du 19ème, dans les années 30 et dans les années 60] ont été étroitement liées aux difficultés de l’impérialisme français. Or nous vivons une nouvelle séquence d’affaiblissement important de l’impérialisme français sur la scène internationale. En témoigne les contestations populaires du Francs CFA en Afrique subsaharienne ou la contestation de la présence des troupes françaises au Sahel. Dans ces séquences la logique de la « reconquête » se légitime par un discours sur la décadence à combattre, l’unité nationale à défendre, l’identité nationale à préserver, les « ennemis de l’intérieur » à démasquer, etc. Faut-il dès lors s’étonner des récentes commémorations d’assassins de l’OAS ou de la tentative de réhabilitation partielle de Pétain par Emmanuel Macron ? En période de crise le fascisme ne doit décidemment jamais être sous-estimé. Le combattre efficacement suppose de pouvoir le reconnaître en dépit des multiples masques qu’il revêt. Le fascisme n’est pas une nostalgie du passé de quelques vieillards. Il est d’abord un projet économique et politique de rétablissement d’un impérialisme par la force. Ce projet s’adapte à son époque et en prend les atours. Le fascisme contemporain a à la fois le même fond que le Vichysme ou l’OAS et une forme spécifique. Il est inutile et dangereux d’attendre des chemises brunes pour se mobiliser. Les fascistes d’aujourd’hui peuvent très bien se vêtir de costumes cravates.
5 – Toujours au gré des archives, cette phrase tirée de Pouvoir ouvrier (janvier 1959, n°2, page 9, La situation algérienne) : Les ouvriers français n’ont pas réussi, depuis quatre ans que dure cette guerre, à vaincre les préjugés racistes que la bourgeoisie entretient depuis un demi-siècle dans toutes les classes sociales sous des formes différentes ; pour eux l’Algérien est resté un bicot.
Mais les massacres de Sétif et Batma en mai 1945 (les événements déclencheurs selon Kateb Yacine), le 14 juillet 1953 (voir ce numéro), les pouvoirs spéciaux du 12 mars 1956 votés à l’Assemblée nationale par toute la Gauche, le manque de soutien aux appelés, le refus politique de l’indépendance par toute cette Gauche, puis, plus tard, l’indifférence face aux massacres du 17 octobre 1961, entre autres, n’ont rien fait pour établir des liens entre les travailleurs français et les travailleurs algériens, situation attisée par les colons petits ou grands et, aujourd’hui, par les nostalgiques de l’Algérie française.
Tous ces faits n’ont-ils pas contribué à ce racisme profond qui demeure ?
Absolument. Il n’y a aucun racisme ouvrier spontané. Celui-ci est le résultat du combat idéologique visant d’une part à diviser les travailleurs pour maximiser le profit et d’autre part à justifier et légitimer hier la colonisation et aujourd’hui l’impérialisme français. Marx a déjà il y a longtemps analysé cette double fonction à propos de la situation irlandaise qui ressemble beaucoup sur certains aspects à l’immigration issues des anciennes colonies en France. Voici ce qu’il écrit en 1870 :
« Ce qui est primordial, c’est que chaque centre industriel et commercial d’Angleterre possède maintenant une classe ouvrière divisée en deux camps hostiles : les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. L’ouvrier anglais moyen déteste l’ouvrier irlandais en qui il voit un concurrent qui dégrade son niveau de vie. Par rapport à l’ouvrier irlandais, il se sent membre de la nation dominante et devient ainsi un instrument que les aristocrates et capitalistes de son pays utilisent contre l’Irlande. Ce faisant, il renforce leur domination sur lui-même. Il se berce de préjugés religieux, sociaux et nationaux contre les travailleurs irlandais. Il se comporte à peu près comme les blancs pauvres vis-à-vis des nègres dans les anciens États esclavagistes des États-Unis. L’Irlandais lui rend avec intérêt la monnaie de sa pièce. Il voit dans l’ouvrier anglais à la fois un complice et un instrument stupide de la domination anglaise en Irlande. Cet antagonisme est artificiellement entretenu et développé par la presse, le clergé et les revues satiriques, bref par tous les moyens dont disposent les classes dominantes. Cet antagonisme est le secret de l’impuissance de la classe ouvrière anglaise, malgré son organisation. C’est le secret du maintien au pouvoir de la classe capitaliste, et celle-ci en est parfaitement consciente. »
Tout me semble encore pertinent dans ce développement de Marx : la production d’un antagonisme interne à la classe ouvrière, la diffusion de préjugés racistes comme moyen, la nécessité de combattre ces préjugés et d’unifier les travailleurs sur la base de leurs intérêts communs et du refus de la surexploitation des immigrés. L’abandon par les organisations ouvrières du combat idéologique contre les préjugés racistes dans la classe ouvrière est le terreau du racisme populaire.
6 – Nous finirons par deux questions supplémentaires, connexes et relatives au thème de ce numéro, en ce soixantième anniversaire de la libération de l’Algérie :
— Est-ce que la France s’est finalement retirée de l’Algérie tout en sachant qu’elle pourrait garder des intérêts économiques : gaz, essais nucléaires… ?
Jusqu’au bout la France à tenté de préserver une mainmise néocoloniale sur l’Algérie. Cela fut le cas lors des dernières années de la colonisation où De Gaulle tente d’imposer une indépendance sans le Sahara à la fois en raison des découvertes pétrolières et pour les besoins d’un terrain d’expérimentation pour les essais nucléaires. Du côté algérien la guerre de libération nationale avait atteint une telle radicalité et suscitée de telles attentes sociales qu’un modèle néocolonial à l’image de ce qui s’était installé en Afrique subsaharienne était impossible. Le peuple algérien était en attente de travail, de terre, d’éducation, etc. Le vocabulaire dominant en Algérie en 1962 est celui du socialisme, de la révolution agraire, de la nationalisation, etc. Les paysans des domaines coloniaux abandonnés par leurs propriétaires s’en emparent et créent des coopératives. Rappeler ces faits est nécessaire pour ne pas être tenté par la binarité dans la réponse à votre question : ou la France s’est retirée ou elle ne s’est pas retirée. En effet je considère que la dépendance vis-à-vis de l’ancienne puissance coloniale a été fonction du rapport de forces c’est-à-dire variable de 1962 à aujourd’hui en fonction de qui était au pouvoir comme classe sociale à Alger. La France préserve effectivement l’accès au pétrole, aux essais nucléaires et à une base militaire lors des accords d’Évian mais ces abcès coloniaux sont immédiatement contestés par l’Etat algérien et disparaitrons progressivement avec comme point final la nationalisation du pétrole en 1971. La petite-bourgeoisie au pouvoir va à la fois promouvoir un réel développement économique indépendant pendant deux décennies et s’enrichir à l’ombre de l’Etat. La libéralisation qui s’enclenche dans la décennie 80 est le signe qu’elle s’est suffisamment enrichie pour jouer le jeu du capitalisme privé. Le temps des privatisations massives est venu et avec lui de la fin des investissements d’Etat et de la paupérisation. Cette politique dite de « l’infitah » [ouverture] se traduira par le retour d’une dépendance économique accrue vis-à-vis de la France.
— Frantz Fanon raconte qu’il avait eu peur pour sa sécurité lorsqu’il a dénoncé les faits des « oligarques » qui allaient prendre le pouvoir à l’Indépendance. Peux-tu nous préciser ces faits ? Ces oligarques sont-ils encore au pouvoir ? Est-ce-que l’armée ou ses généraux ont le pouvoir ou « un » pouvoir ?
Le chapitre « Les mésaventures de la conscience nationale » du livre de Fanon « les damnés de la terre » écrit en 1961 est à la fois un bilan des premières indépendances africaines et un cri d’alerte sur le devenir des pays nouvellement indépendant. Il y met en exergue l’incapacité des bourgeoisies nationale à être les porteuses d’un réel développement indépendant. Ce qu’il a décrit s’est largement réalisé. En ce qui concerne l’Algérie, ce n’est pas une bourgeoisie nationale [qui était inexistante du fait de la colonisation de peuplement] qui s’empara du pouvoir mais la petite bourgeoisie radicale. Force est de constater que deux décennies après, cette petite bourgeoisie [entretemps devenu bourgeoisie par son enrichissement à l’ombre de l’Etat] devient une fervente partisane de la privatisation et du néolibéralisme. Nous n’avons donc pas, selon moi, affaire à des oligarques en 1962. Ce n’est qu’une fois enrichie que cette petite-bourgeoisie abandonne toute référence aux idéaux défendus par la lutte de libération nationale [socialisme, réforme agraire, non-alignement, anti-impérialisme, etc.] pour se transformer en bourgeoisie. Je préfère raisonner en termes de classes sociales plutôt qu’avec les termes « civils » ou « militaires ».
April 14, 2023
La consubstantialité du racisme et du capitalisme et ses conséquences
Cet article est paru dans le n° 22 de la revue de l’Union syndicale Solidaire du Printems 2023
Si théoriquement un capitalisme non raciste est possible, le « capitalisme réel » ou le « capitalisme réellement existant » [c’est-à-dire toutes les expériences connues du capitalisme à ce jour] a systématiquement été caractérisé par l’existence de rapports sociaux racistes d’une part et d’idéologies racistes d’autre part. De même l’affirmation courante de l’existence d’un racisme précapitaliste se réalise sur la base d’une confusion entre les concepts de racisme, d’ethnocentrisme et de xénophobie. Cette confusion n’est pas neutre. Elle rend ahistorique le racisme faisant de lui une constante essentialiste de l’humanité et non une production sociale historiquement datée et systémiquement reliée à des intérêts économiques et sociaux. L’enjeu est de taille car il détermine en partie non négligeable les contenus, les formes, les cibles et les places dans l’agenda militant à la fois de l’antiracisme et de l’anticapitalisme.
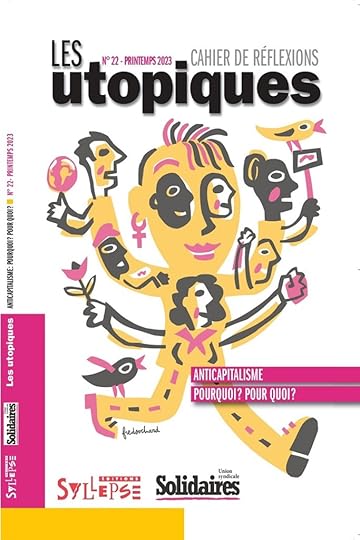
Une consubstantialité historique
L’histoire de l’humanité est depuis la sortie de nos ancêtres de l’ère de la survie absolue et l’apparition de la propriété privée et des classes sociales qui en découlent, une succession de rapports d’exploitation et de domination. Ces rapports ont fréquemment été marqués par l’existence de traitements différenciés selon l’origine des personnes plus ou moins inégalitaires historiquement et géographiquement. L’imposition de ces traitements a été plus ou moins violentes selon les lieux et les époques. Le capitalisme n’a donc ni le monopole de l’inégalité, ni celui du traitement différencié et inégal selon l’origine, ni celui de la violence pour imposer ce traitement. Ces constats suffisent-ils à conclure au fait que le racisme a toujours existé, qu’il est en quelque sorte une constante de l’humanité ?
Tirer une telle conclusion serait une négation des différences essentielles entre les formes de traitements différenciés selon l’origine précapitalistes [ethnocentrisme et xénophobie] et le racisme. Si bien sûr des liens de continuité existent entre les premières et le dernier, ceux-ci ne doivent pas occulter les différences importantes qui les distinguent. Pour éviter une telle confusion, il convient bien sûr de sortir de la plurivocité du terme « racisme ». Le terme est en effet aujourd’hui utilisé dans une multiplicité de signification. Certains se plaignent même d’un « racisme anti-riche ». Précisons donc notre définition de ce concept : le racisme désigne toute idéologie comportant trois affirmations : 1) l’existence d’une division de l’humanité en pseudo « races », 2) la hiérarchisation de celles-ci sur une échelle infériorité/supériorité c’est-à-dire l’affirmation d’une inégalité raciale, 3) la justification d’un traitement inégal selon cette échelle. Logiquement le racisme désigne également les rapports sociaux qui découlent de ce type d’idéologie c’est-à-dire le traitement inégal selon l’appartenance pseudo « raciale ».
Ainsi définit le racisme comme idéologie et comme rapport social est, selon nous précisément daté de la période de transition au capitalisme industriel. C’est ladite « découverte de l’Amérique » c’est-à-dire en fait la destruction violente des sociétés indigènes qui fournit une part essentielle de la masse de capitaux de ce que Marx a appelé « l’accumulation primitive du capital ». C’est l’esclavage qui compléta ensuite cette accumulation inédite structurant pour longtemps et jusqu’à aujourd’hui le monde en un centre dominant et des périphéries dominées. Si le bras armé est espagnol et portugais, les capitaux qui le finance proviennent des banques anglaises, françaises, hollandaises, etc. Les deux couronnes s’endettent pour financer leurs expéditions et reversent en retour en remboursement de dettes et en intérêts une masse de capitaux énorme qui assureront le passage au capitalisme industriel dans la plupart des pays européens. Une expropriation aussi massive et les violences qui l’accompagnent nécessitent la production d’un discours de justification et de légitimation. Le racisme en sera le résultat. Il émerge, se formalise et se déploie en accompagnement idéologique de la violence totale que constitue la « découverte de l’Amérique » puis l’esclavage. Loin d’être une constante essentialiste de l’humanité, le racisme est historiquement datable de 1492. Immanuel Wallerstein a déjà argumenté et documenté depuis longtemps que le capitalisme historique est indissociable du système-monde moderne qui s’installe à partir du seizième siècle d’une part et qu’il ne pouvait pas y avoir de système-monde antérieur au capitalisme d’autre part[1]. Éric Williams a, pour sa part, documenté depuis plus longtemps encore les liens entre l’esclavage et la constitution du capital qui a permis la transition au capitalisme industriel[2]. C’est ainsi dans le même mouvement que se réalise la transition au capitalisme industriel, le colonialisme sur le continent américain et l’apparition du racisme comme idéologie et comme rapport social. Capitalisme, colonialisme et racisme ne sont pas trois réalités distinctes mais trois facettes d’un même processus global émergeant dans une même période historique.
Une consubstantialité logique
L’indissociabilité du racisme et du capitalisme ne se limite cependant pas qu’à cette dimension historique. Elle résulte également des lois même de fonctionnement du mode de production capitaliste. Sans être exhaustif, du fait des limites de taille de cet article, soulignons une de ces lois conduisant à une production permanente de racisme sous le capitalisme d’hier comme d’aujourd’hui. Cette loi est celle de la maximisation de la plus-value extorquée c’est-à-dire du travail non payé. Cette maximisation conduit inévitablement à la résistance du mouvement ouvrier. Chaque garantie arrachée par le mouvement ouvrier, chaque hausse des salaires ou réductions du temps de travail gagnée par la lutte syndicale, chaque conquis social obtenu, etc., est de fait une limite imposée à cette maximisation.
Rappelons à ce niveau que la vague de colonisation du dix-neuvième siècle s’argumente fréquemment à partir de ce qui était appelé « la question sociale » c’est-à-dire en fait des luttes du mouvement ouvrier. La peur de la révolution sociale est pour de nombreux défenseurs de la colonisation un argument essentiel. « Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche et du pauvre[3] » clame Ernest Renan. « Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires[4] » poursuit Victor Hugo. « L’idée qui me tient le plus à cœur, c’est la solution au problème social : pour sauver les quarante millions d’habitants du Royaume-Uni d’une guerre civile meurtrière, nous les colonisateurs, devons conquérir des terres nouvelles afin d’y installer l’excédent de notre population […], d’y trouver de nouveaux débouchés pour les produits de nos fabriques et de nos mines. L’Empire, ai-je toujours dit, est une question de ventre. Si vous voulez éviter la guerre civile, il faut devenir impérialiste[5] » surenchérit Cecil Rhodes. Outre le colonialisme, l’appel à l’immigration est une autre tentative de contourner cette limite à la maximisation de la plus-value qu’est le mouvement ouvrier.
Le capital à la recherche du profit maximum appelle sans cesse de nouvelles forces de travail à qui il impose une « surexploitation ». Pour ce faire le marché du travail est segmenté avec certains segments caractérisés par « l’exploitation » et d’autre par la « surexploitation ». Une telle logique impose bien sûr dans la durée une tendance à la baisse des conditions de salaire et de travail de tous les travailleurs mais également une disparité dans les conditions d’exploitation à chaque séquence historique. L’immigration constitue de par la précarité organisée de son séjour, de par la distance avec le mouvement ouvrier au moment de son arrivée, de par le racisme entretenu idéologiquement, etc., une formidable variable d’ajustement structurel conduisant à son assignation aux secteurs de surexploitations. Le racisme apparaît de ce fait comme l’accompagnement idéologique de cette segmentation du marché du travail à partir d’un critère d’origine.
Loin de s’enclencher avec l’arrivée des premières immigrations européennes, cette logique de segmentation du marché du travail et la production de son accompagnement idéologique qu’est le racisme, est présente dès les premiers pas du capitalisme. Dans un ouvrage récent nous avons restitués les secteurs d’emplois des « immigrations » bretonnes ou auvergnates et les discours idéologiques racistes qui les ont accompagnés[6]. Discours politiques et médiatiques, articles de journaux, surenchères de l’extrême-droite, rapports à prétention savante, etc., se construisent sur un mode culturaliste et essentialiste, avec les mêmes stigmates racistes : non assimilabilité ou intégration impossible, communautarisme, menace pour l’identité, inégalités biologiques ou culturelles, etc. Quand aux secteurs d’emplois, on retrouve sans surprise ceux marqués par des salaires moindres, des conditions de travail les plus difficiles, des protections inférieures à la moyenne, etc. Bien sûr avec le temps ces travailleurs surexploités entrent en lutte contre cette surexploitation et investissent le mouvement ouvrier. Le temps est alors venu de les remplacer par d’autres à qui s’appliquent la même logique d’assignation à la surexploitation et de diffusion de la même construction raciste. C’est pourquoi nous proposons de ne pas dater l’immigration de l’arrivée des premières immigrations européennes mais d’y inclure les immigrations intra-nationales. Les raisons de quitter la Bretagne ou l’Auvergne pour se diriger vers les centres industriels ont été de même nature que celles qui débouchent sur les immigrations contemporaines, à savoir, la destruction des modes de production antérieurs [communautaires, de petites propriétés familiales, etc.]. Les processus d’assignation aux secteurs de surexploitation sont également similaires. Le discours raciste d’accompagnement idéologique également. Le racisme comme idéologie et comme rapport social a ainsi été une constante des Bretons d’hier au maliens d’aujourd’hui, des auvergnats d’hier aux algériens d’aujourd’hui.
La même loi de maximisation de la plus-value conduit logiquement à l’extension permanente du capitalisme c’est-à-dire à la mondialisation. Chaque détenteur du capital, individuel ou collectif, est poussé à l’extension sous peine de disparaître sous les coups de la concurrence. Comme le soulignait Aimé Césaire[7], le capitalisme ne peut fonctionner qu’en s’étendant. C’est pourquoi il est erroné de dater la mondialisation de la décennie 90 du siècle dernier. Tout au plus peut-on parler d’un nouveau cycle de mondialisation contemporain. Quant à la mondialisation proprement dite, elle est présente dès le capitalisme infantile qui, comme nous l’avons souligné plus haut, s’accompagne du colonialisme. C’est ainsi la même soif de plus-value qui conduit à la fois à la délocalisation des entreprises et à la construction juridique des sans-papiers pour les assigner aux emplois de surexploitation non délocalisables. Sans surprise l’accompagnement idéologique raciste est au rendez-vous pour ces travailleurs sans-papiers.
Capitalisme, néocolonialisme et racisme ne sont pas trois réalités distinctes mais trois facettes indissociables du fonctionnement du même mode de production.
La dynamique des rapports de domination
L’humanité a connut de nombreux rapports de domination et d’exploitation avant le capitalisme : esclavagisme antique, patriarcat, âgisme, féodalisme, etc. La logique commune de tous ces rapports est la transformation des différences [de sexe, d’âge, de nationalité, d’origine, etc.] en hiérarchie. A chaque fois que des classes dominées ont imposé par leurs luttes la fin d’un « âge de la domination et de l’exploitation », la ou les nouvelles classes dominantes ont recyclé les discours idéologiques essentialistes du passé pour les mettre au service du nouveau mode de production dominant. Le capitalisme ne met pas fin à l’idéologie patriarcale mais la reformule pour la mettre à son service. Il ne met pas fin aujourd’hui au racisme colonial mais le reformule pour justifier l’assignation des anciens indigènes devenus immigrés [et leurs enfants pourtant français de naissance et de socialisation] aux emplois de surexploitation.
Le processus n’est d’ailleurs pas seulement valable sur le plan des idéologies mais également sur le plan des rapports sociaux. Si la colonisation a exporté les rapports capitalistes dans les colonies, elle n’en a pas pour autant détruit entièrement les rapports de domination antérieurs et en particulier les rapports féodaux. Dans de nombreuses colonies, elle a maintenu ces rapports pour les mettre au service du nouveau mode de production dominant, le capitalisme. De même les contrats de travail qui touchent les saisonniers en Europe en général et en France en particulier empruntent certains aspects du rapport féodal et en particulier l’attachement de l’immigré à son employeur [le titre de séjour étant lié au contrat de travail] comme jadis l’attachement du serf au seigneur. C’est cette logique jusqu’ici limitée aux contrats saisonniers que tente de généraliser la future loi Darmanin et sa fameuse pseudo régularisation pour les métiers en tension. Les titulaires du nouveau titre de séjour prévu par cette loi, ne pourrons pas quitter leur employeur sous peine de perdre leur titre de séjour.
Sur le plan des idéologies, les emprunts aux légitimations du passé, sont caractéristiques des premières formulations du racisme biologique des débuts du capitalisme. Ces premières formulations du racisme biologique n’hésitent pas à reprendre la « théorie des deux races » qui a servi longtemps de légitimation au féodalisme. Lorsque qu’il entre en usage en France au XVe siècle le terme « race » est, en effet, utilisé pour justifier le pouvoir féodal. Selon la théorie des deux races, la France serait constituée de deux races primitives, l’une conquérante et l’autre conquise. La noblesse serait ainsi d’origine franque et les serfs d’origine gauloise. De manière significative cette théorisation posant les Francs comme supérieurs [et donc appelés aux tâches militaires et destinés à dominer] et les gaulois comme inférieurs [et donc appelés au travail et destinés à être dominés] est brandie pour se distinguer des serfs mais également pour s’opposer aux anoblissements et maintenir la « pureté » de la race de seigneurs. Il s’agissait en quelque sorte de s’opposer au « grand remplacement » des nobles par la fermeture du second ordre. « Le noble de sang » était ainsi opposer au « noble de papier » comme aujourd’hui certains oppose la « français de souche » et le « français de papiers ».
Ces idées n’associent cependant pas encore « race » et « couleur » d’une part et l’argument biologique n’est que rarement utilisé d’autre part. Il faudra attendre l’introduction de la culture du sucre aux Antilles et l’esclavage qui l’accompagne pour que « ces idées se transforment en une idéologie raciste permettant la domination d’un groupe humain par un autre, sur la base d’une présumée supériorité morale et intellectuelle, laquelle est censée être reflétée au physique par des distinctions naturelles » explique l’historien Pierre Boulle[8].
C’est en généralisant à l’ensemble des européens les « qualités » et « supériorités » jusqu’à présent réservées aux nobles et en prétendant le prouver scientifiquement qu’apparaît le racisme comme idéologie en justification du racisme comme rapport social concrétisé par l’esclavage, lui-même résultat de l’expansion du capitalisme. Un Ernest Renan peut dès lors écrire : « Autant les conquêtes entre races égales doivent être blâmées, autant la régénération des races inférieures par les races supérieures est dans l’ordre providentiel de l’humanité. L’homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé ; sa lourde main est mieux faite pour manier l’épée que l’outil servile… Versez cette dévorante activité sur des pays qui comme la Chine, appellent la conquête étrangère… chacun sera dans son rôle. La nature a fait une race d’ouvriers ; c’est la race chinoise, d’une dextérité de main merveilleuse sans presque aucun sentiment de l’honneur… gouvernez-la avec justice… elle sera satisfaite ; – une race de travailleurs de la terre, c’est le nègre, soyez bon pour lui et humain et tout sera dans l’ordre ; – une race de maîtres et de soldats, c’est la race européenne[9]. »
Les continuités et emprunts dans les discours idéologiques de domination soulignent que le racisme au sens où nous l’entendons à des racines précapitalistes mais ce n’est que dans le cadre de l’esclavage [lui-même résultat des besoins de l’extension capitaliste] et pour le servir que s’opère la mue qualitative donnant naissance au racisme.
L’indissociabilité de l’antiracisme et de
l’anticapitalisme
Le racisme comme idéologie émerge en support et en légitimation du racisme comme rapport social, lui-même indissociable du capitalisme qui impose sa logique à l’ensemble des rapports sociaux d’une société où domine le mode de production capitaliste. Combattre le racisme de manière conséquente suppose en conséquence de s’attaquer aux rapports sociaux racistes dans la mesure où ce sont ceux-ci qui constituent la base matérielle de l’idéologie raciste. Toute victoire, même minime, contre l’inégalité de traitement en fonction de l’origine, tout recul des discriminations racistes imposé par la lutte, fait plus conséquemment reculer le racisme que tous les programmes antiracistes aussi exhaustifs soient-ils. Cela ne signifie pas qu’il faille sous-estimer le combat idéologique, l’idéologie raciste contribuant en retour à produire et reproduire les rapports sociaux racistes qui sont eux-mêmes au service de la reproduction du capitalisme.
Il en découle qu’un antiracisme qui ne serait pas anticapitaliste serait pour le mieux un antiracisme incohérent et pour le pire une opération de diversion détournant l’énergie militante des véritables lieux et mécanismes de production et de reproduction du racisme. Ainsi en est-il de la tentative de limiter l’antiracisme à la lutte contre les discours et actes racistes individuels. Ce faisant un tel antiracisme détourne des véritables cibles que sont le racisme d’Etat [tel que produit par des politiques d’Etat de production des sans-papiers, de précarisation du séjour des immigrés « réguliers », de banalisation des discriminations racistes], le racisme systémique [produit par le fonctionnement même du système économique et de ses conséquences sur l’ensemble des sphères d’existence : logement, emploi, formation, etc.] et du racisme institutionnel [produit par le fonctionnement des différentes institutions]. Ce qui relie les politiques d’Etat dominantes, le fonctionnement du système économique et les différentes institutions c’est justement qu’elles sont la fois produites et productrices par/de la logique capitaliste. Un antiracisme qui ne serait pas anticapitaliste serait ainsi un antiracisme d’apparat. Un tel antiracisme est d’autant plus consensuel qu’il est d’apparat.
A l’inverse un anticapitalisme, même àdiscours radical, qui ne serait pas antiraciste ou qui relèguerait l’antiracisme à une place subalterne de l’agenda des mobilisations, passerait à côté d’un des principaux mécanismes de hiérarchisation de la classe ouvrière et d’organisation de la concurrence entre force de travail qui est une des dimensions centrales du capitalisme. Le capitalisme français concret, celui qui fonctionne réellement, se déploie en ayant intégré les rapports sociaux racistes dans ses logiques de fonctionnement et de reproduction. Il est vain d’opposer « race » et « classe », chacun de ces rapports sociaux n’étant que des facettes d’une même logique capitaliste d’ensemble. Mener conséquemment le combat antiraciste n’est pas sortir de la lutte des classes mais y entrer concrètement. Un anticapitalisme occultant ou sous-estimant le combat antiraciste serait pour le mieux un anticapitalisme décharné, un anticapitalisme s’attaquant à un capitalisme abstrait et non au capitalisme réellement existant.
[1] Voir à ce sujet Immanuel Wallerstein, Le Capitalisme historique, Paris, La Découverte, 1985 ; Comprendre le monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde, Paris, La Découverte, 2006 ; « La construction de l’économie-monde européenne, 1450-1750 », in Beaujard Philippe, Berger Laurent, Norel Philippe (dir.), Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La Découverte, 2009, pp. 191-202.
[2] Éric Williams, Capitalisme et esclavage, Présence Africaine, Paris, 1998.
[3] Ernest Renan, Réforme intellectuelle et morale, Callmann Lévy, 1871, p. 92.
[4] Victor Hugo, discours sur l’Afrique (1894), Actes et Paroles IV. Depuis l’exil (1876-1885), consultable sur le site « Inlibro veritas », pp. 87-88.
[5] Cecil Rhodes, journal Neue Zeit, n° 1, 1898, p. 304.
[6] Bouamama Saïd, Des classes dangereuses à l’ennemi intérieur. Capitalisme, Immigration, Racisme, Syllepse, Paris, 2021.
[7] Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 2004, p. 9
[8] Pierre Henri Boulle, La construction du concept de race dans la France d’ancien régime, Outre-Mers. Revue d’histoire, n° 336-337, 2002, p. 155.
[9] Ernest Renan, Réforme intellectuelle et morale, Callmann Lévy, 1871, p. 93.
March 13, 2023
Néocolonialisme et paupérisation systémique
Cet article est paru dans la revue des possibles de l’association « attac », n° 35, printemps 2023
L’essence du néo-colonialisme, c’est que l’État qui y est assujetti est théoriquement indépendant, possède tous les insignes de la souveraineté sur le plan international. Mais en réalité son économie, et par conséquent sa politique, sont manipulées de l’extérieur.
Kwame Nkrumah, Le néocolonialisme. Dernier stade de l’impérialisme[1]
La Méditerranée se transformant en cimetière géant depuis plusieurs années, un Sahel endeuillé quotidiennement par les violences dites « djihadistes », des manifestations populaires pour le départ des troupes françaises de cette même région touchant désormais toute l’Afrique de l’Ouest, une croissance de nombreux pays africains ne s’accompagnant ni d’un développement ni d’une baisse de la pauvreté, etc., autant de faits qui sont incompréhensibles si on ne les relie pas aux rapports économiques qui régulent les liens entre les pays dominant l’économie mondiale et les pays dominés par elle. Ne pas prendre en compte ces rapports économiques (et leurs suites logiques, conséquences et facteurs de reproduction, à savoir les rapports politiques, culturelles, etc.) conduit à la situation actuelle d’une « gauche » globalement muette sur les pratiques prédatrices des classes dominantes européennes, d’une « gauche » marquée par un angle mort à propos de l’anti-impérialisme. Sortir de cet angle mort suppose de saisir les invariants et les mutations entre le colonialisme comme système et ce qui est appelé par Nkrumah « néocolonialisme » dans la citation mise en exergue (section1), de mesurer l’ampleur des effets de ce néocolonialisme sur les conditions d’existence des peuples néo- colonisés (section 2), de prendre la mesure également de la séquence actuelle dite de « mondialisation » (section 3) et enfin de relier des questions volontairement séparées par le discours dominant, entre mondialisation et politique migratoire ou entre crise dite « djihadiste » et mondialisation par exemple (section 4).
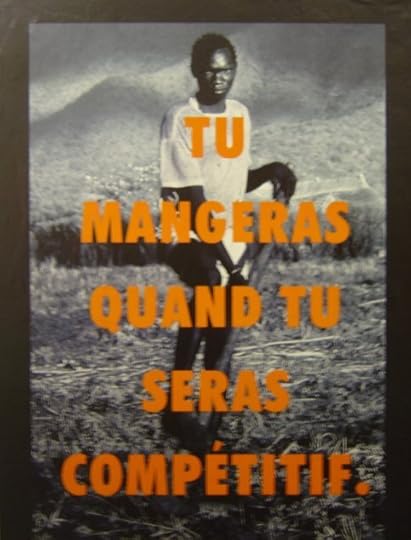 Du colonialisme au néocolonialisme
Du colonialisme au néocolonialismeIl existe de multiples définitions du colonialisme. Certaines se centrent sur l’invasion et l’occupation militaire, d’autres sur les idéologies justificatrices, d’autres encore sur les formes diverses qu’il a pris selon les colonisateurs et les séquences historiques (de peuplement, d’exploitation économique, etc.), d’autres enfin sur les motivations diverses qui ont accompagné son imposition (règlement de la question sociale par l’exportation dans les colonies des pauvres européens, préoccupation géostratégique face aux concurrents, etc.). Ces définitions ne sont pas erronées mais restent partielles. Elles ne permettent pas d’éclairer le rôle et la fonction qu’a joué le colonialisme et que joue aujourd’hui le néocolonialisme dans la construction des sociétés européennes d’une part et dans l’organisation polarisée du monde jusqu’à aujourd’hui d’autre part. Ce qui caractérise, selon nous, le colonialisme c’est qu’il est d’abord constitué par l’extension à l’ensemble de la planète du mode de production capitaliste. C’est cette extension qui a permis la réunion des conditions du passage du capitalisme commercial au capitalisme industriel, la réunion des richesses nécessaires à ce bond qualitatif[2]. C’est le pillage des civilisations indigènes des Amériques puis l’esclavage qui ont réuni ces conditions. Il n’y a donc pas eu capitalisme industriel puis colonialisme, mais développement simultané et en interaction de l’un et de l’autre.
Si nous apportons ces précisions, c’est qu’elles sont essentielles pour saisir les conséquences « ici et là-bas » de l’imposition du colonialisme. Pour qu’il puisse jouer cette fonction de développement économique « ici », il a fallu mettre en dépendance totale les économies de « là-bas », les contraindre à l’extraversion, les faire fonctionner pour satisfaire les besoins des économies « d’ici ». Avec le colonialisme, le monde est désormais unifié mais non homogénéisé[3]. Le capitalisme qui s’impose « là- bas » est dépendant du capitalisme qui se développe « ici ». Le premier est au service du second. Le développement économique, l’amélioration de la condition ouvrière, les progrès des sciences et techniques à un pôle sont rendus possibles par une croissance sans développement, une surexploitation sans limite, une pauvreté endémique à un autre. C’est pourquoi le colonialisme doit, selon nous, se définir, comme étant d’abord un processus de mises en dépendance faisant fonctionner une économie au service d’une autre[4].
Un double facteur va faire émerger historiquement la nécessité d’une mutation de ce système de domination. Le premier est constitué de la monopolisation grandissante dans les économies « d’ici » exigeant un élargissement des lieux d’approvisionnement en matières premières et en force de travail et l’accès à un marché plus vaste. Cet élargissement est contradictoire avec le vieux pacte colonial réservant les matières premières et le marché d’un territoire à la puissance qui l’occupe[5]. Le second est tout simplement la révolte des colonisés qui, si elle n’a jamais cessé, a trouvé néanmoins dans les mutations des rapports de forces consécutives à la Seconde guerre mondiale, un contexte plus favorable à sa massification et à sa radicalisation. Les indépendances ont en été le résultat.
2. Néocolonialisme et maintien de la dépendance
La décennie 1950 est celle de la radicalisation des luttes pour l’indépendance en Afrique. Les guerres de libération armées qui éclatent en Algérie, au Cameroun et au Kenya font craindre une généralisation à l’ensemble des colonies et une radicalisation des projets de rupture avec le colonialisme. Ce dernier s’adaptera en mutant en colonialisme indirect ou néocolonialisme. Les indépendances sont corsetées par un double mécanisme. Le premier est constitué du caractère inégal du marché mondial assignant les économies africaines à des monoproductions tournées vers l’exportation. Le second par toute une série d’accords (économiques, monétaires, politiques, culturels, militaires, etc.) reproduisant un fonctionnement « là-bas » selon les besoins des économies « d’ici ».
Bien entendu les tentatives de sortir de ce carcan n’ont pas manqué. Les pays membres du groupe dit de « Casablanca » dénoncent ainsi le néocolonialisme dans la décennie 1960 et tentent de s’en libérer par des politiques de recentrage sur le marché national, de réforme agraire, d’industrialisation, etc. Le Ghana, l’Algérie, le Mali, la Guinée, etc., tentent tous des expériences différentes mais convergentes de sortie de l’économie extravertie. Ils feront l’objet de déstabilisations économiques comme en Guinée ou en Algérie, de coups d’État comme au Ghana ou au Mali.
Pour qu’une telle transition ait lieu, les pays colonisateurs ont dû momentanément faire des concessions politiques (indépendances formelles) et économiques (une redistribution de la valeur entre anciennes puissances coloniales et anciens pays colonisés moins inégale que sous la colonisation directe). Ces concessions étaient incontournables au regard de l’ampleur des attentes et des espoirs investis dans les indépendances par les peuples. Pour ces derniers, l’indépendance prenait la signification de l’accès à la terre, à l’école, à l’alimentation, etc. Même les gouvernements les plus timorés et les plus dépendants des anciennes puissances coloniales sont contraints de mettre en œuvre des politiques de scolarisation, de redistributions sociales, d’accès aux soins, etc., qui font des deux premières décennies des indépendances des périodes d’amélioration des conditions de vie des masses populaires. Il est essentiel de rappeler ces faits à un moment où se déploie un discours nihiliste et afro-pessimiste comparant la situation actuelle à celle de l’époque coloniale. Dénonçant ces discours révisionnistes, Samir Amin rappelait à juste titre l’exemple suivant :
« En 1960, au Congo belge, il y avait neuf – pas dix ! – Congolais à peau noire qui avaient fait des études supérieures, six religieux et trois civils – je n’ai jamais su, ou j’ai oublié, s’ils étaient deux médecins et un avocat ou deux avocats et un médecin. Après trente ans d’un des plus odieux régimes de l’Afrique et du monde, celui de Mobutu, aujourd’hui, il n’y en a pas neuf, mais trois millions. Donc le pire régime a fait des milliers de fois mieux que la belle colonisation. Ceux qui ont mon âge et qui ont connu des parties du tiers-monde de l’époque de mon enfance savent que ça n’a plus rien à voir avec aujourd’hui. Et ce qui existe aujourd’hui, les peuples du Sud ont dû le conquérir, on ne le leur a pas donné, rien n’a été donné[6]. »
Ces progrès se déployaient cependant sur la base d’un marché mondial resté fondamentalement inégal et d’une répartition internationale du travail assignant les nouveaux pays indépendants à des productions de matières premières non transformées. C’est cette base qui permettra l’offensive dite « néolibérale » qui débouchera sur la « mondialisation », dont l’outil premier fut constitué par les plans d’ajustement structurel du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. La disparition de l’URSS et avec elle de l’ensemble des équilibres issus de la Seconde guerre mondiale accéléra le mouvement. Le temps des concessions était terminé et le système de prédation néocoloniale pouvait prendre toute son ampleur.
3. Les effets du néocolonialisme à l’ère de la mondialisation
La mondialisation capitaliste signifie pour les pays néo-colonisés une véritable descente aux enfers. Si elle se traduit dans certains pays par une hausse des taux de croissance et du PNB du fait de la délocalisation des entreprises vers les bassins de main-d’œuvre bon marché, elle se concrétise également par une chute des conditions matérielles d’existence, un accès à la santé et à l’enseignement en régression massive par rapport à la période précédente, une fragilisation forte de la petite paysannerie familiale se traduisant par un exode rural massif et une urbanisation incontrôlée, un exode des « cerveaux » vers les pays du centre, etc. Il n’est pas inutile de rappeler les deux séquences principales de ce film qui se déploie depuis les années 1980.
La première séquence est celle d’un encouragement à l’endettement par les anciennes puissances coloniales d’une part et par les institutions financières internationales pendant les décennies 1960 et 1970. L’accès aux prêts est encouragé et la dette est véritablement promue. Les lubies les plus farfelues de certains chefs d’État sont financées par la dette internationale. Les projets industriels les plus irrationnels également. Si certains pays tentent d’utiliser cet endettement à des fins de développements réels, d’autres au contraire sombrent dans des taux d’endettement faramineux sans aucun effet économique réel.
La seconde séquence sera celle des plans d’ajustement structurel imposés pour accéder aux prêts internationaux. Le discours et les pratiques de toutes les institutions financières (celle de l’Union Européenne, du FMI, de la Banque mondiale, etc.) vont converger pour conditionner désormais ces prêts à des conditionnalités politiques et économiques. Celles-ci sont entièrement centrées sur le principe libéral du retrait de l’État : privatisations, fin du soutien étatique aux prix des produits de première nécessité et, plus généralement, baisse des budgets sociaux, baisse des dépenses de l’État, démantèlement et privatisation des services publics, fin du monopole d’État sur le commerce extérieur, etc., telles sont les conditionnalités qu’ont imposées les 241 programmes d’ajustement pilotés par la Banque mondiale et le FMI auxquels il faut ajouter les mesures du même type imposées dans le cadre des accords bilatéraux ou des accords avec l’Union européenne. Dans cette logique néolibérale, le rôle de l’État est réduit à celui de garant du cadre juridique permettant le bon fonctionnement des lois du marché. Un tel État est incapable de mener à bien une construction nationale.
Un double effet se produira progressivement au cours des décennies suivantes. Le premier est l’installation d’une paupérisation grandissante inégalement répartie socialement et territorialement. La baisse des dépenses d’État ne se réalise pas de manière homogène, avec comme conséquence une hausse des inégalités entre villes et campagnes et entre les différentes régions. Les programmes d’ajustement imposent de surcroît une concentration des dépenses publiques sur un ou quelques secteurs d’exportation. Chacune des nations tend ainsi à se scinder en une « zone utile » et une « zone inutile ». La fracture territoriale antérieure s’aggrave, laissant parfois certaines régions dans un quasi-abandon sur laquelle fleuriront des métastases « ethniques », « djihadistes », « tribales », etc. Loin d’être une caractéristique en essence de ces peuples, ces métastases sont le résultat logique de la destruction des logiques nationales par le néolibéralisme sans limite. L’économiste camerounais Bernard Founou-Tchuigoua décrit comme suit cette destruction et ses effets politiques et sociaux :
« Une construction nationale ne peut être purement idéologique. Elle se doit aussi de posséder des bases matérielles. Le progrès social en fait nécessairement partie. Si un mécanisme de régression sociale s’installe durablement, et donne à la population l’impression qu’elle ne pourra pas s’en sortir, c’est le désastre. C’est ce qui se produit avec le débridage de la logique de marché, par le biais des programmes d’ajustement structurel. Imposés de l’extérieur […]. Ces programmes ont donc signifié la remise en cause du projet de construction nationale. […] La désaffection populaire pour l’État-nation tel qu’existant encore ouvre alors la porte aux revendications ayant pour objectif non plus la cohésion nationale mais une communauté ethnique, religieuse ou linguistique… »[7]
Le second effet est un bouleversement de l’ensemble des structures sociales. Les traits principaux de ce bouleversement sont désormais documentés par la recherche. Sans être exhaustif, rappelons-en quelques-uns. Le premier est celui d’une prolétarisation conséquente. La mondialisation capitaliste et ses délocalisations ont transféré une part non négligeable de la classe ouvrière des centres dominants vers les périphéries dominées : en 1950, la part des ouvriers de l’industrie travaillant dans un pays de la périphérie dominée était de 34 %. Cette part est de 53 % en 1980 et de 79 % en 2010 (soit en chiffres absolus, 541 millions d’ouvriers contre 145 millions dans les pays du centre). Le transfert de main-d’œuvre est encore plus important si on centre l’analyse sur le travail de manufacture : « 83 % de la main-d’œuvre de manufacture dans le monde vit et travaille dans les pays du Sud » résume l’économiste John Smith. Et cette hausse de la part des pays de la périphérie s’est déployée sur fond d’une hausse importante de la « main-d’œuvre mondiale effective » entre 1980 et 2006 selon les propres chiffres du FMI. Celle-ci est passée de 1,9 milliard en 1980 à 3,1 milliards en 2006. La recherche de gain sur le coût de la main-d’œuvre étant le moteur des délocalisations, les conditions de salaire et de travail de ces nouveaux prolétaires sont généralement calamiteuses. La baisse des capacités d’intervention étatique, les réformes libérales du droit du travail, la rapidité du processus d’exode rural, etc., qui sont des effets logiques des programmes d’ajustement se traduisent par une condition ouvrière désastreuse.
Le second trait est la destruction encore plus massive de l’emploi agricole. L’ouverture des marchés et la libéralisation du commerce extérieur imposées par les plans d’ajustement structurel ont ainsi fait chuter la part de l’emploi agricole dans la population active des pays périphériques de 73 % en 1960 à 48 % en 2007[8]. Il en découle une accélération de l’exode rural et l’entassement d’une masse grandissante de chômeurs à la périphérie des grandes agglomérations. Ces emplois agricoles perdus proviennent essentiellement de l’agriculture familiale, la libéralisation du commerce extérieur l’ayant mise en concurrence avec les grands groupes de l’agro-alimentaire des pays dominants.
Le troisième trait est ce qui est communément appelé la « fuite des cerveaux » c’est-à-dire en fait l’importation par les centres dominants de la main- d’œuvre qualifiée dont la formation a été financée par les budgets nationaux des pays de la périphérie dominée. Une des conditionnalités imposées par les PAS est, en effet, la privatisation des services publics qui sont depuis les indépendances le principal employeur de la main-d’œuvre qualifiée. Les chercheurs, enseignants, techniciens, médecins, etc., des pays périphériques sont ainsi rapidement jetés dans la précarité. Ils emprunteront nombreux les chemins de l’émigration qui jusque-là ne concernait essentiellement que la force de travail peu qualifiée. Les chiffres sont parlants comme en témoigne une étude de 2013 portant sur la « fuite des médecins africains » vers les États-Unis : « La fuite des médecins de l’Afrique subsaharienne vers les États-Unis a démarré pour de bon au milieu des années 1980 et s’est accélérée dans les années 1990 au cours des années d’application des programmes d’ajustement structurel imposés par […] le FMI et la Banque mondiale[9]. » Les médecins algériens ou moyen-orientaux dans les hôpitaux français témoignent du même processus en Europe.
La taille de cet article ne permet pas de décrire exhaustivement tous les traits du bouleversement des structures sociales des pays de la périphérie dominés par une mondialisation qui signifie de fait la disparition de toutes les entraves au néocolonialisme. Les trois mentionnées ci-dessus suffisent cependant à en faire approcher l’ampleur et le caractère durable des effets à court terme et à long terme, dans les domaines économiques mais aussi politiques, culturels, de cohésion sociale et territoriale, etc.
4. Les effets du néocolonialisme mondialisé dans les centres dominants
Comme dans tout système, les différentes parties finissent progressivement par se mettre en cohérence. Progressivement les politiques migratoires des pays des centres dominants furent transformées pour les adapter au néocolonialisme mondialisé. Les possibilités légales d’émigration furent ainsi quasiment réduites au regroupement familial suscitant ainsi un volant de main-d’œuvre sans papiers contrainte d’accepter une surexploitation. Les secteurs et activités non délocalisables comme le BTP, l’aide aux personnes ou la restauration purent ainsi bénéficier d’une main- d’œuvre à un coût record comparable aux coûts dont bénéficiaient les entreprises délocalisées. L’accompagnement idéologique sous la forme des discours sur « l’explosion démographique africain », sur le danger d’une « ruée migratoire » ou d’un « grand remplacement », fut diffusé à grande échelle afin d’éteindre les indignations possibles devant le cynisme de la nouvelle politique migratoire. Il a en outre l’avantage de légitimer la militarisation du contrôle des candidats-réfugiés aboutissant à faire de la Méditerranée un cimetière permanent à ciel ouvert. Un autre visage des damnés de la terre aujourd’hui est cette figure des damnés de la mer.
L’invention de la carte de séjour « talent » et la thématique de « l’immigration choisie » est un autre exemple de cette banalisation du cynisme dans la politique migratoire. Elles viennent à point pour justifier le « pillage des cerveaux » que nous avons évoqué plus haut. Cette force de travail qualifiée qui n’a rien coûté aux centres dominants peut compenser le manque d’effectifs dans les services publics produit par les politiques austéritaires depuis plusieurs décennies. La crise du COVID a par exemple mis en exergue que les services des urgences étaient, pour une partie importante, dépendants de cette main-d’œuvre étrangère. Bien sûr, celle-ci est recrutée comme contractuelle c’est- à-dire avec des conditions de salaires, de temps et de condition de travail moindres. Ici aussi, le néocolonialisme a des conséquences en termes de régressions sociales.
Le capitalisme qui apparaît en Europe ne peut fonctionner qu’en s’étendant. Ce faisant, il a, par la violence de l’esclavage et de la colonisation, unifié le monde sans pour autant l’homogénéiser. La structuration du monde en centres dominants faisant fonctionner à leur profit des économies périphériques est un résultat inévitable de ce capitalisme. C’est pourquoi le colonialisme peut se définir comme étant la mise en dépendance du reste du monde. Contraint par les luttes des peuples colonisés à se transformer, il change de visage et mute en néocolonialisme. La dépendance est tout aussi importante mais se déroule sous de nouveaux oripeaux. Cette mutation contrainte se traduit dans un premier temps par une amélioration réelle des conditions d’existence des peuples colonisés en attente de terre, d’emplois, d’accès à la santé et à l’éducation, etc. Le changement de rapport de force mondial qui se déploie à partir des décennies 1980 et 1990 est l’occasion de revenir à la logique de dépendance « pure », c’est-à-dire débarrassée des concessions faites sur la base du rapport des forces de la séquence historique antérieure. Sans surprise, reviennent avec cette dépendance « pure » tous les maux de dépendance, à savoir paupérisation, précarisation, baisse des conditions d’existence, ruine de l’agriculture familiale, exode rural massif, bidonvilles, etc. C’est ce système que nous proposons d’appeler le néocolonialisme mondialisé du fait de son lien avec la mondialisation capitaliste. Mais cette mondialisation a également fait apparaître de nouvelles puissances économiques comme les BRICS permettant pour les néo-colonies d’élargir leurs champs des possibles en matière de partenariat économique. Le néocolonialisme est ainsi confronté aux contradictions de sa propre mondialisation. C’est ce que démontrent les difficultés françaises en Centrafrique, au Burkina Faso ou au Mali. Mais cela est déjà une autre histoire, une histoire en voie d’écriture.
Saïd Bouamama est sociologue et militant du Front uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP).
[1] Kwame Nkrumah, Le néocolonialisme. Dernier stade de l’impérialisme, Paris, Présence Africaine (1965), 1973, p. 9.
[2] Voir sur cet aspect l’incontournable Éric Williams, Capitalisme été esclavage, Paris, Présence Africaine, 1968.
[3] Voir sur cet aspect : Samir Amin, Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme périphériques, Paris, Minuit, 1973
[4] Pour une analyse plus détaillée de ce processus historique nous renvoyons à notre ouvrage : Saïd Bouamama, Des classes dangereuses à l’ennemi de l’intérieur. Capitalisme, Immigration, racisme, Paris, Syllepse, 2021.
[5] Voir sur cet aspect : Mehdi Ben Barka, Option révolutionnaire au Maroc. Écrits politiques 1957-1965, Paris, Syllepse, 1999, p. 229-230.
[6] Samir Amin, « La dernière grande leçon de Samir Amin », entretien, Le Grand Continent, 13 août 2018, consultable sur le site legrandcontinent.eu.
[7] Bernard Founou Tchuigoua, « L’échec de l’ajustement en Afrique », Alternatives Sud, n° 2, 1994, p. 7
[8] Bureau international du travail, Indicateurs clés du marché du travail, Genève, 2007, chapitre 4.
[9] Akhenaten Benjamin, Caglar Ozden, et Sten Vermund, Physician Emigration from Sub-Saharan Africa to the United States, PLOS Medicine, volume 10, n° 12, 2013, p. 16
February 20, 2023
CINQUANTE ANS APRÈS SA MORT (1/3)
Il y a 50 ans Amilcar Cabral était assassiné. Pour lui rendre hommage la revue Afique XXI publie le chapitre d’un de mes livres qui lui est consacré
Biographie · Le 20 janvier 1973, Amílcar Cabral était assassiné à Conakry avant même l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Cinquante ans après sa mort, celui que l’on surnommait à l’époque le « Lénine africain » est une référence sur le continent. Retour sur le parcours intellectuel d’un révolutionnaire africain.
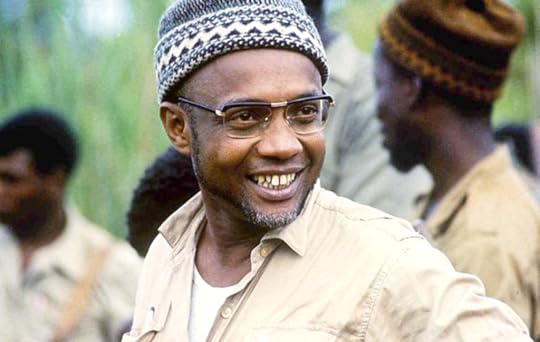
Ce texte est tiré de l’ouvrage de Saïd Bouamama, Figures de la révolution africaine. De Kenyatta à Sankara, La Découverte, 2014, 300 pages.
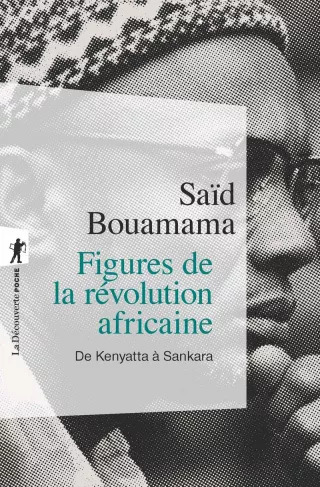
Parce qu’il a pleine conscience des erreurs commises par ceux qui l’ont précédé sur le chemin de la « révolution africaine », parce qu’il suit en pensée et en acte le chemin tracé par Frantz Fanon, parce qu’il est pleinement inscrit dans les luttes internationalistes du tournant des années 1960-1970, Amílcar Cabral (1924-1973) pourrait symboliser la fin de la première phase offensive du mouvement d’émancipation du continent africain. Au moment où se déclenche la lutte armée en Guinée « portugaise », en 1963, deux Afriques se côtoient : l’une prépare la Tricontinentale anti-impérialiste et l’autre s’enfonce dans la trahison des espoirs populaires.
C’est dans ce contexte que se développe la pensée politique de Cabral, qui bénéficie d’un certain recul depuis les premières indépendances africaines. La force de cette pensée vient tout autant de son approche matérialiste et de sa méfiance à l’égard du dogmatisme que de l’attention qu’il porte à la pratique du pouvoir, telle qu’il l’expérimente dans les régions libérées de Guinée-Bissau.
En 1953, au moment de quitter Lisbonne pour son Afrique natale après un séjour de plusieurs années consacré à des études d’agronomie, Cabral s’interroge sur le « rôle de l’étudiant africain ». Selon lui, la première tâche à entreprendre pour cette jeunesse instruite est ce qu’il appelle la « réafricanisation des esprits » :
Puisque nous savons que toute la politique colonialiste repose essentiellement sur le déracinement du natif, l’étudiant africain doit, à une certaine étape de son évolution intellectuelle, se retourner le plus possible vers son âme transfigurée. Voilà à notre avis la première condition de l’authenticité. L’Africain doit se sentir africain et s’exprimer comme tel1.
Cette conviction théorique et politique est d’abord le fruit d’une expérience vécue. Né en 1924 à Bafatá, en Guinée portugaise, de parents originaires du Cap-Vert, Cabral appartient, comme beaucoup de dirigeants nationalistes africains de sa génération, à la petite bourgeoisie de couleur. Son père, Juvenal Cabral, fils d’un propriétaire rural aisé, est instituteur. Sa mère, d’abord domestique, tient ensuite un petit commerce, « une des plus importantes aspirations pour les Africains de l’époque 2 ».
RACISME ET FAMINELes natifs du Cap-Vert comme ceux de toutes les îles de l’empire sont juridiquement des indigènes assimilés, c’est-à-dire disposant des mêmes droits que les Portugais. Malgré cette égalité formelle, la société cap-verdienne reste hiérarchisée selon la couleur. Juvenal Cabral lui-même ne subit pas sans agacement cette logique assimilationniste raciste et inégalitaire. Sur l’acte de naissance de son fils, le prénom est orthographié « Hamilcar » en référence au célèbre général carthaginois qui combattit l’Empire romain pendant les guerres puniques. Donner des prénoms d’Africains célèbres fait partie de ces petites résistances symboliques qui se déploient quand la domination coloniale semble encore invincible.
Né en Guinée, Cabral poursuit sa scolarité au Cap-Vert. Il y est le témoin de la terrible sécheresse de 1941 qui, suivie d’une interminable famine, se solde par la mort de près de 50 000 personnes entre 1941 et 1948 (plus du tiers de la population), dans l’indifférence totale des autorités portugaises. Ce n’est donc pas un lycéen naïf qui débarque au Portugal en 1945 pour y mener des études d’agronomie. Rapidement, et parce qu’il faut bien « se refaire une famille », comme le soulignera son futur compagnon d’armes, l’Angolais Mário de Andrade3, Cabral se rapproche des autres Africains présents à Lisbonne.
Ceux-ci se retrouvent en particulier à La Casa dos Estudantes do Império (CEI). Créée en 1933, cette institution a pour objectif d’aider – et de contrôler… – les étudiants originaires des colonies. Elle est un lieu où se rencontrent la plupart des futures figures nationalistes des colonies portugaises. […] Bien vite, le groupe d’étudiants africains qui commence à se structurer et à s’accoutumer aux règles de l’action clandestine se sent à l’étroit et mal à son aise dans cette CEI qui, en plus d’être étroitement surveillée par la police, accueille de surcroît les enfants de colons qui font leurs études à Lisbonne. En 1951, ils créent clandestinement le Centro de Estudos Africanos (CEA), avec pour objectif de promouvoir la culture des peuples noirs colonisés et de diffuser les créations artistiques africaines. C’est par le biais de ce centre qu’une relation est établie avec les courants parisiens de la « négritude ». En 1953, cinq membres du CEI contribuent ainsi au numéro spécial de la revue Présence africaine intitulé « Les Étudiant noirs parlent ».
LE CHOIX DU RETOUR[…] Le retour de Cabral en Afrique est un choix politique autant qu’un choix de vie. Il renonce à un poste de chercheur à la station agronomique de Lisbonne pour un emploi d’ingénieur de deuxième classe en Guinée. Il théorisera plus tard ce renoncement personnel aux avantages matériels dans l’une de ses thèses les plus célèbres, celle du « suicide de classe » de la petite bourgeoisie.
En attendant, son expérience au sein des services de l’exploitation agricole et forestière, où il est chargé du recensement agricole, lui permet de sillonner la Guinée, pendant deux ans, et d’observer le fonctionnement sociopolitique des populations locales. Grâce à ce travail d’observation et à l’abondante documentation à laquelle il a accès, Cabral peut étudier les positions des différentes composantes de la société guinéenne à l’égard des forces coloniales. Ces matériaux s’ajoutent à ceux recueillis sur le Cap-Vert au cours d’un travail de recherche effectué pendant ses études d’agronomie. Au sortir du recensement, il est profondément imprégné de la réalité et de la diversité du pays et de ses habitants. Ces observations lui permettront plus tard de proposer une analyse subtile des sociétés guinéenne et cap-verdienne et d’élaborer une stratégie de lutte adaptée à la réalité concrète.
Les préoccupations de Cabral sont en effet concrètes : il est rentré au pays pour organiser un mouvement nationaliste. Dès 1954, il tente de créer une association sociale, culturelle et sportive à Bissau, capitale de la Guinée portugaise. L’administration coloniale ne s’y trompe pas : elle rejette la demande de création de l’association et oblige Cabral à quitter le territoire guinéen (où il n’est autorisé à revenir qu’une fois par an). Il est de nouveau contraint à l’exil à Lisbonne. Pendant les quatre années qui suivent, de 1954 à 1958, il travaille pour plusieurs compagnies agricoles, ce qui lui permet de faire de longues missions en Angola et d’en profiter pour renouer avec ses connaissances angolaises. […]
LES DÉBUTS DIFFICILES DU PAIGCHors de Guinée, Cabral ne peut pas participer, en 1955, à la création de la première organisation nationaliste guinéenne, le Mouvement pour l’indépendance nationale de la Guinée (MING). Initiée par Rafael Barbosa, l’expérience du MING, rapidement dissous, est éphémère. Lors de son séjour annuel en Guinée, en septembre 1956, Cabral est en revanche à l’initiative, avec cinq autres militants, de la création du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), dont il est désigné secrétaire général.
De façon particulièrement originale pour l’époque, la nouvelle organisation inclut d’emblée à la fois le Cap-Vert et la Guinée dans sa lutte, produisant ainsi une situation de combat binational unique en Afrique. De façon nettement moins innovante en revanche, le nouveau parti concentre son action sur les villes, à la recherche de ce « prolétariat » voué, selon l’orthodoxie marxiste, à diriger la lutte. Mais, dans un pays où la classe ouvrière est quasi inexistante, cette approche dogmatique ne peut mener qu’à une impasse. L’historien britannique Basil Davidson précise ainsi dans son livre – publié à Londres en 1969, traduit en français la même année et préfacé par Cabral lui-même – que le PAIGC ne comptait, trois ans après sa création, qu’« une cinquantaine de membres actifs, mais presque tous à Bissau. Peu d’entre eux devaient avoir des liens étroits avec les villages 4 ».
Il faut attendre un événement tragique pour que la stratégie évolue. Initiée par le PAIGC, une manifestation des travailleurs du port de Bissau se solde, le 3 août 1959, par un massacre sur les docks de Pidjiguiti. Cinquante dockers sont tués par les forces de l’ordre portugaises, et on dénombre plus de cent blessés. Ce drame constitue, selon Jean Ziegler, « un tournant de la réflexion et de la stratégie des nationalistes révolutionnaires5 ». La conférence du parti qui se tient un mois plus tard pour tirer le bilan de la situation décide d’un changement radical d’orientation : le passage à la lutte armée et l’implantation dans les milieux ruraux. La méfiance à l’égard du dogmatisme et la nécessité d’un effort théorique ancré dans les réalités concrètes sont les deux leçons que tire le secrétaire général du massacre de Pidjiguiti.
L’IMPORTANCE DE « LA RÉALITÉ CONCRÈTE »Cabral reconnaît que la lecture de Lénine a contribué à la formation de sa pensée politique (Mehdi Ben Barka le surnommait d’ailleurs le « Lénine africain »). Il retient en particulier du révolutionnaire russe la nécessité d’une « analyse concrète de chaque situation concrète6 ». Cette formule qu’il reprend à son compte s’adapte entièrement au travail auquel se livre Cabral après 1959.
Intervenant au Caire en mars 1961 à la troisième Conférence des peuples africains, et tirant à cette occasion le bilan des indépendances acquises au cours de l’année précédente, il s’interroge sur la victoire du néocolonialisme dans plusieurs pays africains. Cet échec des mouvements progressistes est moins le signe d’une « crise de croissance » que d’une « crise de la connaissance », relève-t-il : trop de mouvements de libération sont coupés « de la réalité concrète » dans laquelle ils évoluent et négligent les « expériences locales » des populations qu’ils défendent7.
Ayant décidé d’implanter les forces nationalistes dans les campagnes après le massacre de 1959, Cabral met immédiatement en œuvre cet effort de « connaissance ». Il se replonge dans la masse de données recueillie au cours de ses études et à l’occasion du recensement. Plus tard, il exposera les résultats de son travail dans le cadre d’un séminaire organisé par le Centre Frantz Fanon de Milan8. À la différence de nombreux leaders africains qui se contentent de concepts larges comme « peuple » ou « masse laborieuse », souligne l’universitaire états-unien Ronald Chilcote9, Cabral se penche sur « les divisions et les contradictions » pour comprendre concrètement ce « peuple » et ces « masses ».
UN LONG TRAVAIL DE PRÉPARATION À LA LUTTE ARMÉEPrenant en compte les structures sociales des différents groupes ethniques qui cohabitent en Guinée rurale, mais aussi les contradictions d’intérêts qui les caractérisent, Cabral élabore une analyse fine du rapport de chacune des composantes (ethnique et sociale) au pouvoir colonial. Pour la Guinée urbaine, Cabral distingue les fonctionnaires, les salariés et les « déclassés ». Concernant les salariés, l’auteur précise qu’il prend « soin de ne pas les appeler prolétariat ou classe ouvrière ». Surtout, il mentionne une catégorie de « sans-classe » comptant de nombreux jeunes venant des campagnes et ayant gardé des liens avec elles. Une analyse spécifique aussi détaillée est faite pour les îles du Cap-Vert 10.
L’analyse concrète de la situation concrète « a servi de base à notre lutte de libération », précise Cabral en introduction de son intervention de Milan. Effectivement, la lutte armée déclenchée en 1963 a été précédée par quatre ans de préparation politique avec des militants, formés par Cabral lui-même, et des « sans-classe », qui ont aidé à la prise de contact dans les campagnes. Ainsi, les premières bases ont été créées chez les Balante, qui apparaissent dans l’analyse sociale de Cabral comme le groupe le plus opposé au pouvoir colonial, pendant qu’un long travail de persuasion a été mené en direction des paysans des autres groupes décrits par Cabral comme les groupes sociaux les plus exploités.
 Guérilleros du PAIGC, en 1964.© Wikimedia Commons
Guérilleros du PAIGC, en 1964.© Wikimedia CommonsSi Cabral met toujours la théorie au service de la pratique, il dispose pour cela d’un meilleur recul sur les évolutions historiques en cours sur le continent africain. La décolonisation portugaise étant en retard sur les autres, Cabral et ses camarades peuvent étudier les expériences, négatives ou positives, des premières indépendances et bénéficient de l’apport théorique et politique de ceux qui les ont précédés sur le chemin de la libération. Comme le souligne l’historien Achille Mbembe, Cabral a en particulier pris la mesure de l’importance des réflexions de Frantz Fanon : « Sans [ces] réflexions sur la nature de la paysannerie, le pouvoir des “masses” ou le potentiel révolutionnaire des classes lumpen, l’œuvre d’Amílcar Cabral n’aurait sans doute pas pris la forme qu’elle finira par prendre. Les trajectoires de la lutte armée contre le colonialisme portugais en Guinée-Bissau, en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique non plus11 ».
Mais la revendication d’un héritage ne signifie pas pour Cabral un mimétisme dogmatique. En témoigne le désaccord qui se fait jour entre Fanon, conseiller du GPRA [Gouvernement provisoire de la République algérienne], et les responsables nationalistes des colonies portugaises à propos de l’opportunité de déclencher la lutte armée.
« NOUS SOMMES DES MILITANTS ARMÉS ET NON PAS DES MILITAIRES »Rencontrant le psychiatre martiniquais au deuxième Congrès des écrivains et des artistes noirs, à Rome, en 1959, Mário de Andrade rappelle la position de Fanon sur ce sujet : « Fanon était un immédiatiste, il ne faisait pas de quartiers, lui, à l’impérialisme. Il fallait ouvrir un front, immédiatement, en Angola et au Mozambique simultanément12. » Alors que Fanon propose une préparation militaire pour les militants des colonies portugaises, Cabral, en pleine réorientation stratégique depuis le massacre de Pidjiguiti, défend l’idée d’un long et patient travail politique auprès de la paysannerie comme étape préalable au déclenchement de la lutte armée. De fait, cette dernière n’est déclenchée qu’en 1963.
Ce travail gigantesque de « conscientisation » des paysans et de formation des militants ne s’est pas fait sans erreurs ni problèmes. Le premier congrès du PAIGC en 1964, à Cassaca, en « zone libérée », est en grande partie consacré à ces écueils. La première année de guérilla a en effet mis en évidence des tendances au militarisme et à l’ethnisme. Alors que l’armée portugaise, qui espère encore pouvoir vaincre militairement la résistance, met une pression permanente sur les partisans, certains combattants dérapent. « Des commandants d’unités de la guérilla d’origine balante avaient lâché des porcs dans les mosquées des villages fulas », note par exemple Jean Ziegler. Cabral se prononce pour que ces actes soient sanctionnés. Pour lui, la lutte est d’abord politique avant d’être militaire. Ce qu’il résume en une formule qu’il ne cessera de répéter : « Nous sommes des militants armés et non pas des militaires13. »
Outre sa volonté de toujours ancrer son action dans les situations concrètes, le besoin d’une théorie révolutionnaire est la seconde conviction de Cabral. Au cours de la première réunion de la Tricontinentale, qui se tient en 1966 dans l’hôtel Habana Libre, au cœur de la capitale cubaine, il entreprend d’expliquer l’importance de la théorie et comment celle-ci s’articule selon lui à la pratique révolutionnaire14. Car, relève-t-il, « s’il est vrai qu’une révolution peut échouer, même alimentée par des théories parfaitement conçues, personne n’a encore réalisé une révolution victorieuse sans théorie révolutionnaire ».
UNIVERSALISER L’APPROCHE MARXISTESur de nombreuses questions, l’intervention de Cabral à La Havane, intitulée « L’arme de la théorie », avance des propositions nouvelles, qui ont toutes en commun d’appeler à l’émergence d’un savoir théorique et politique adapté aux réalités africaines. Ce faisant, c’est une petite révolution (dans la révolution) que propose celui que le journaliste Roger Faligot décrit comme la « star du Habana Libre 15 » : devant ce cénacle de marxistes venus des quatre coins du monde et qui l’acclament à tout rompre, le « Lénine africain » suggère ni plus ni moins que de revoir la théorie marxiste de la lutte des classes ! « Ceux qui affirment – et, à notre point de vue, avec raison – que la force motrice de l’histoire est la lutte de classes », explique finement Cabral, devraient peut-être « réviser cette assertion, afin de la préciser et de lui donner un champ d’application encore plus vaste » en s’intéressant aux « caractéristiques essentielles de certains peuples colonisés, c’est-à-dire dominés par l’impérialisme. »
Poursuivant son raisonnement, devant un public médusé, Cabral propose une périodisation de l’histoire de l’humanité qui, tout en restant cohérente avec l’analyse marxiste, tente de prendre en compte les réalités africaines. Se démarquant des analyses dogmatiques cherchant partout à identifier les « cinq phases » de l’histoire de l’humanité (le communisme primitif, l’esclavagisme, le féodalisme, le capitalisme, le socialisme), Cabral propose une analyse alternative qui non seulement ne distingue que trois étapes (une phase initiale « communautaire et pastorale » sans classes sociales, une phase caractérisée par l’existence de classes sociales et de lutte des classes, et enfin, troisième phase, l’émergence de « sociétés socialistes et communistes »), mais qui postule en outre que ces trois « phases » peuvent être concomitantes, en particulier du fait de l’agression coloniale :
Au niveau de l’humanité ou d’une partie de l’humanité (groupes humains d’une même région, d’un ou plusieurs continents), ces trois phases (ou deux d’entre elles) peuvent être simultanées comme le prouve la réalité actuelle aussi bien que le passé. Ceci résulte du développement inégal des sociétés humaines, soit pour des raisons internes, soit par l’influence accélératrice ou retardatrice sur leur évolution d’un ou plusieurs facteurs extérieurs.
Proposant donc de réfléchir plus en profondeur à la notion de « classe » et au processus original de formation des antagonismes sociaux en Afrique précoloniale, le militant guinéen appelle ses camarades rassemblés au Habana Libre à une universalisation concrète de l’approche marxiste. Et c’est grâce à ce processus d’universalisation, condition sine qua non d’une authentique révolution à l’échelle mondiale, que le tiers monde retrouve enfin sa place dans l’« Histoire ». […]
LUTTER « CONTRE NOS PROPRES FAIBLESSES »Non seulement les sociétés colonisées ont une histoire précoloniale mais, précise Cabral, c’est justement la colonisation qui freine, détourne et atrophie l’histoire africaine en la rendant dépendante d’un facteur externe. La libération nationale ne peut plus se confondre avec l’indépendance formelle. Elle est « la reconquête de la personnalité historique de ce peuple, elle est son retour à l’histoire au moyen de la destruction de la domination impérialiste à laquelle il était soumis ». Toutes les classes sociales ne sont pas également intéressées à cette destruction qui « correspond nécessairement à une révolution ».
Si les délégués réunis à La Havane font un triomphe au révolutionnaire guinéen et à son « discours décoiffant », comme le note Roger Faligot, Cabral ne s’arrête pas en si bon chemin. Avec le franc-parler qui le caractérise, il insiste pour que la dénonciation rhétorique de l’« impérialisme » ne constitue pas l’alpha et l’oméga du combat révolutionnaire et pour que son auditoire prenne conscience de cet autre combat trop souvent négligé : « la lutte contre nos propres faiblesses ». « Notre expérience, insiste-t-il, nous enseigne que, dans le cadre général de la lutte quotidienne, quelles que soient les difficultés créées par l’ennemi, cette lutte contre nous-mêmes est la plus difficile, aussi bien au moment présent que dans l’avenir de nos peuples. » C’est dans le cadre de cette lutte que Cabral livre, devant un auditoire qui, comme lui, n’est pas issu majoritairement des milieux les plus défavorisés des pays dominés, sa théorie du « suicide » de classe.
 Amílcar Cabral en pleine discussion avec Fidel Castro, en janvier 1966, à Cuba.DR
Amílcar Cabral en pleine discussion avec Fidel Castro, en janvier 1966, à Cuba.DRPour bien comprendre cette théorie qui a fait couler beaucoup d’encre, sans doute faut-il préciser, avec l’historien Yves Benot, ce que Cabral entend par « petite bourgeoisie » : « La petite bourgeoisie dont parle Cabral à La Havane ne nous paraît pas être une classe, mais un groupe d’intellectuels qui doit se constituer en intelligentsia de la classe ouvrière en formation16. » Nous ne sommes pas loin de la notion d’intellectuel organique développée par Antonio Gramsci. Peut-être faut-il aussi préciser que cette théorie n’est pas totalement neuve puisque de nombreux intellectuels, marxistes ou non, ont bien avant Cabral réfléchi sur ce thème.
[…] Cabral poursuit sa réflexion sur le rôle de cette « bourgeoisie nationale » qui sert presque toujours de canal d’influence dans les pays formellement indépendants et l’enrichit grâce à son expérience du « pouvoir » dans les zones libérées par les mouvements de libération luttant contre le colonialisme portugais. Les propos de Cabral à La Havane méritent d’être médités par toutes les « élites » qui prétendent parler et agir au nom du peuple :
Pour ne pas trahir ces objectifs, la petite bourgeoisie n’a qu’un seul chemin : renforcer sa conscience révolutionnaire, répudier les tentatives d’embourgeoisement et les sollicitations naturelles de sa mentalité de classe, s’identifier aux classes laborieuses, ne pas s’opposer au développement normal du processus de la révolution. Cela signifie que, pour remplir parfaitement le rôle qui lui revient dans la lutte de libération nationale, la petite bourgeoisie révolutionnaire doit être capable de se suicider comme classe pour ressusciter comme travailleur révolutionnaire, entièrement identifiée avec les aspirations les plus profondes du peuple auquel elle appartient. Cette alternative – trahir la révolution ou se suicider comme classe – constitue le choix de la petite bourgeoisie dans le cadre général de la libération nationale.
[…] On l’a dit, la crainte de Cabral est de voir la « petite bourgeoisie », toute révolutionnaire qu’elle puisse être, confisquer pour elle-même le pouvoir. Son insistance sur l’idéologie et la formation politique, et sur le rapport des militants avec les paysans dans les zones libérées par le PAIGC, vise à contrecarrer ce danger. Surtout, Cabral en appelle de manière matérialiste à organiser ces zones pour qu’elles puissent assurer un passage du pouvoir des militants du parti aux populations.
LA CULTURE COMME ARMELa réalité lui donne rapidement raison. Alors que les milieux paysans abandonnent progressivement leur méfiance initiale, les zones libérées s’étendent rapidement dans cette Guinée de moins en moins « portugaise ». Dès 1966, elles représentent 50 % du territoire et atteignent 70 % de celui-ci à partir de 1968. Ayant tiré le bilan des affrontements fratricides, au sein du FLN [Front de libération nationale] algérien, entre l’armée de l’extérieur et les maquisards de l’intérieur, le secrétaire général du PAIGC refuse toute idée de gouvernement en exil. C’est depuis les zones libérées elles-mêmes qu’il faut défendre, y compris sur la scène internationale, le droit à l’indépendance : « [La situation de la Guinée] est comparable à celle d’un État indépendant dont une partie du territoire national, notamment les centres urbains, est occupée par des forces militaires étrangères17. »
La manière dont Cabral conçoit les « zones libérées » est indissociable d’un autre de ses apports théoriques : la culture comme arme. Ce n’est qu’après plusieurs années de vie dans les zones libérées qu’il entreprend d’en tirer des leçons théoriques. Il synthétise celles-ci dans deux contributions : « Libération nationale et culture » (1970) et « La Culture et le combat pour l’indépendance » (1972).
Dans le premier texte, Cabral commence sa théorisation en reprenant quelques idées-forces de Fanon. La violence totale du colonisateur, souligne-t-il après le psychiatre algéro-antillais, provoque inévitablement une résistance chez le colonisé. Cette résistance s’origine dans la volonté farouche des milieux populaires de préserver leur dignité individuelle et collective. Cette résistance que l’on peut qualifier de « culturelle » est la première défaite du colonisateur. […]
La culture a une histoire correspondant à l’évolution de cette base matérielle mais contribue aussi aux évolutions historiques. « Fruit de l’histoire, d’un peuple, remarque Cabral, la culture détermine en même temps l’histoire. » Cette approche permet au révolutionnaire guinéen de se démarquer des approches essentialistes de la culture africaine très en vogue en Afrique au tournant des années 1960-1970 sous la forme des discours sur l’« authenticité », le retour aux « sources » ou le « socialisme africain ». La culture existe indépendamment de « la volonté des hommes, de la couleur de leur peau ou de la forme des yeux […]. On ne peut prétendre qu’existent des cultures continentales ou raciales ». Au sein d’un même continent ou d’une même société les cultures seront aussi diverses que le sont leurs bases matérielles et politiques18.
TRANSFORMER LA VIE CONCRÈTE DES HOMMESAyant souligné l’apport incontournable de la résistance culturelle dans le processus d’émancipation, Cabral en souligne ensuite les limites. La colonisation, rappelle-t-il, c’est aussi la confiscation de l’histoire. La culture qui a permis de maintenir la résistance à la colonisation a cessé en partie de se développer, de continuer son parcours historique, de poursuivre son mouvement. Cette approche fait une nouvelle fois écho aux propos de Fanon sur l’atrophie de la culture en situation coloniale. La reprise de l’initiative historique par la lutte de libération nationale doit en conséquence se traduire par une opération de choix entre ce qui est encore vivant dans la culture et ce qui est une simple trace du passé maintenue formellement pour s’opposer à la domination coloniale. C’est dire l’opposition de Cabral à toutes les approches culturalistes atemporelles, à savoir :
Les éloges sélectifs, l’exaltation systématique des vertus sans condamner les défauts ; l’acceptation aveugle des valeurs de la culture sans considération de ce qu’elle a ou peut avoir de négatif, de réactionnaire ou de régressif ; la confusion entre ce qui est l’expression d’une réalité historique objective et matérielle et ce qui semble une création de l’esprit ou le résultat d’une nature spécifique ; la liaison absurde des créations artistiques, qu’elles soient valables ou non, à de prétendues caractéristiques d’une race.
Il s’agit donc bien de reprendre la dynamique historique interrompue par la colonisation, y compris sur le plan de la culture. L’expulsion définitive de la domination qui, pour Cabral, est bien plus difficile que le départ physique du colonisateur suppose de remettre en marche la culture. Mais une telle entreprise ne peut pas se réaliser de manière idéaliste, elle suppose de transformer la vie concrète des hommes. On comprend dès lors l’obstination de Cabral à faire des zones libérées des lieux où se transforme la vie concrète, où s’expérimentent de nouveaux rapports sociaux, où se forge une nation :
La domination impérialiste étant la négation du processus historique de la société dominée [et] nécessairement de son processus culturel, la lutte de libération est avant tout un acte de culture. […] La dynamique de la lutte exige la pratique de la démocratie, de la critique et de l’autocritique, la participation croissante des populations à la gestion de leur vie, l’alphabétisation, la création d’écoles et de services sanitaires, la formation de cadres issus des milieux paysans et ouvriers, et bien d’autres réalisations qui impliquent une véritable marche forcée de la société sur la route du progrès culturel. Cela montre que la lutte de libération n’est pas qu’un fait culturel, elle est aussi un facteur culturel.
[…] Dans l’esprit de Cabral, les zones libérées doivent être des lieux de transformation sociale sans attendre l’indépendance. Dans son approche matérialiste, il s’agit d’abord de faire l’expérience d’une autre vie matérielle. Le secrétaire général du PAIGC avertit les militants :
N’oubliez jamais que les hommes ne se battent pas pour des idées, pour des choses qui n’existent que dans la tête des individus. Les hommes se battent […] afin de vivre mieux et en paix, de connaître le progrès et d’assurer l’avenir de leurs enfants. La libération nationale, la lutte contre le colonialisme, la construction de la paix et du progrès – l’indépendance –, tout cela ce sont des mots creux et sans signification pour le peuple s’ils ne sont pas traduits en termes de véritables améliorations dans ses conditions de vie. Cela ne sert à rien de libérer un pays si son peuple ne peut jouir des biens essentiels de la vie quotidienne.19
Il s’agit également de mettre en place, dans ces zones, un fonctionnement politique permettant une transformation progressive des hommes et le transfert du pouvoir des « dirigeants » aux paysans. Plusieurs observateurs ont témoigné de l’organisation de ces zones et de l’effort d’y construire une organisation démocratique. Tous les domaines de la vie sociale sont concernés, avec le souci constant d’impliquer les populations dans les prises de décision. Loin d’être seulement des bases pour le combat militaire, il s’agit donc de faire des zones libérées des anticipations de la vie future.
PENSEUR DE LA LIBÉRATIONDe cette ambition découle la volonté d’inscrire l’action transformatrice dans le temps long, en faisant preuve de patience. « Nous devons lutter sans précipitation hasardeuse, lutter par étapes, développer la lutte progressivement, sans faire de grand bond », insiste l’agronome militant en prenant l’image de la graine qui doit prendre le temps nécessaire pour apporter fleurs et fruits. Ayant sous les yeux le spectacle d’une Afrique largement maintenue sous le joug néocolonial, Cabral pense désormais qu’il faut « faire la révolution en combattant » car « nous ne luttons pas simplement pour mettre un drapeau dans notre pays et pour avoir un hymne » mais pour que :
… plus jamais nos peuples ne soient exploités, pas seulement par des impérialistes, pas seulement par les Européens, pas seulement par les gens de peau blanche, parce que nous ne confondons pas l’exploitation ou les facteurs d’exploitation avec la couleur de peau des hommes ; nous ne voulons plus d’exploitation chez nous, même pas par des Noirs 20.
Ne pas se contenter d’une indépendance formelle, avoir comme ambition une libération sociale du continent dans une vision de lutte mondiale des dominés, se donner les moyens théoriques et pratiques pour y parvenir, telles sont les conclusions de l’évolution politique d’Amílcar Cabral qui, à bien des égards, prolonge celle de Frantz Fanon. Car, comme le souligne justement Edward Saïd, « Fanon et Cabral […] n’ont pas seulement pensé la résistance et la décolonisation, mais aussi la libération21 ».
Cela est inacceptable pour le système impérialiste dans sa globalité. Le 20 janvier 1973, Cabral est assassiné dans la banlieue de Conakry. Si toutes les circonstances du meurtre ne sont pas encore éclaircies, la police secrète portugaise en est incontestablement l’instigatrice, et le système impérialiste, dans son ensemble, le bénéficiaire.
January 8, 2023
Dépassionner sans désincarner. Les conditions du dépassement du trauma colonial

Ce texte a été publié dans le numéro 138 de la revue Ecarts d’identité paru au premier semestre 2022
Dans un ouvrage publié en 2003 nous insistions sur la nécessité de « dépassionner sans désincarner » les débats sur la colonisation en général et sur la guerre d’Algérie en particulier[i]. Vingt ans après ce nécessaire travail [sans lequel le trauma colonial tend à se reproduire et dans certaines circonstances à s’exacerber] reste encore à accomplir. Le silence sur un trauma collectif [et donc aussi individuel] ou son euphémisation ne le font pas disparaître. Les appels à l’oubli et à « se tourner vers l’avenir » ne sont que des incantations vaines si ne sont pas réunies les conditions politiques du dépassement. Prendre au sérieux ces conditions suppose beaucoup plus que la logique, encore trop souvent dominante, des « torts partagés » et/ou des « mémoires contradictoires et/ou juxtaposées ». Cette prise de mesure des conditions politiques d’un dépassement nécessite, selon nous, de caractériser la séquence coloniale algérienne d’une part, de saisir ses effets et impacts sur les trajectoires personnelles sur la longue durée d’autre part et d’interroger les facteurs de reproduction du trauma hérité pour une troisième part.
Qualifier le réel
Abdelmalek Sayad qualifiait l’immigration algérienne d’exemplaire en raison du caractère « exemplaire » de la colonisation de l’Algérie qu’il décrivait comme suit : « colonisation totale, systématique, intensive, colonisation de peuplement, colonisation des biens et des richesses, du sol et sous-sol, colonisation des hommes (corps et âmes), surtout colonisation précoce ne pouvant qu’entraîner des effets majeurs […][ii]. » En soulignant le caractère « exemplaire » de l’immigration algérienne, il vise à mettre en exergue le caractère « d’idéal-type » de la colonisation de l’Algérie et de l’immigration qui en découle en tant que rapport de domination. L’immigration algérienne réunit, en les poussant à l’extrême, les traits et les processus en œuvre pour toute colonisation et toute immigration [du moins celles enclenchées par une colonisation] à des degrés moindres et moins exacerbés. La focalisation sur les horreurs de la guerre d’Algérie depuis quelques décennies a eu paradoxalement pour effet en France de voiler pour le mieux et d’occulter pour le pire l’ampleur des violences de la conquête puis de la colonisation. Or c’est cette ampleur qui est constitutif du trauma collectif continué par les violences de la période 1954-1962. Pour ne citer qu’un chiffre, citons l’évaluation du démographe Kamel Kateb : « La surmortalité, du fait de la guerre de conquête et des opérations de pacification, pourrait alors être estimée à 825 000 morts, pendant les quarante-cinq premières années de la colonisation (1830-1875)[iii]. » Il convient souligne l’auteur d’ajouter à ces chiffres ceux de « l’émigration consécutive à la conquête » et « la mortalité provoquée par les famines et les épidémies ». Ces quelques chiffres sont, bien entendu, à rapprocher des évaluations de la population algérienne en 1830 qui varient rappelle l’auteur de 1 à 3 millions. La base matérielle du trauma collectif est indiscutable : entre un quart et un tiers de la population. Les violences du reste de la période coloniale, celle décuplées de la guerre d’Algérie, les déplacements massifs et déracinement de population des dernières années de celle-ci, etc., ne font que continuer ce trauma initial.
Mais la colonisation de l’Algérie n’a pas fait que bousculer les indigènes, elle a eu un impact tout aussi important [quoique bien entendu différent] non seulement sur les colons mais sur la société colonisatrice elle-même. Frantz Fanon comme Aimé Césaire, ont à plusieurs reprises insistées, sur cette transformation de la société colonisatrice. Les mécanismes de reproduction à l’œuvre sont nombreux à agir pour maintenir ce passé dans l’expérience concrète des héritiers de l’immigration algérienne. Les représentations infériorisantes et essentialiste de l’indigène nécessaire à la légitimation de l’ordre colonial tendent à se reproduire pour leurs enfants devenus français, les places sociales qui leurs sont liées tendent à se reproduire également sous la forme de discriminations d’autant plus violentes qu’elles sont inconscientes, l’image de l’islam et des musulmans restent imprégnée par celle véhiculée par le discours colonial, les pratiques administratives [le contrôle au faciès par exemple ou plus globalement le traitement d’exception] issues de l’expérience coloniale perdurent en partie pour les français issus de celle-ci, etc. Bref les inégalités du présent sont à la fois en lien avec celles du passé et ravivent un trauma collectif d’autant plus puissant qu’il est silencié.
Un silence assourdissant
Ce n’est, bien entendu pas, par goût de mettre en concurrence les victimes ou par injonction de repentance que nous rappelons ces données mais parce qu’elles sont incontournables pour saisir l’impact durable sur l’ensemble du corps social algérien, sur l’ensemble des héritiers de l’immigration algérienne et dans chacune des trajectoires familiales. Le silence a été en effet massif pour des raisons différentes selon les acteurs. Les parents des héritiers de l’immigration algérienne, qu’ils aient été engagés pour l’indépendance ou non, qu’ils aient été « harkis » ou « nationalistes » se sont tus ou n’ont parlés de la colonisation en général et de la guerre d’Algérie en particulier que de manière parcellaire en opposition avec le caractère total de leur expérience coloniale. La volonté de ne pas faire entrave à la réussite des enfants est l’explication que nous avons le plus fréquemment rencontrée lors de nos nombreuses enquêtes auprès de ces parents. « L’idée que les « souffrances » de cette période et les rancœurs accumulées pouvaient avoir des conséquences sur les enfants a amené de nombreux parents à se taire[iv] » écrivions-nous il y a déjà vingt ans. A cela s’ajoute, bien entendu, la difficulté constatée dans d’autres expériences traumatiques, de simplement émettre une parole sur celle-ci.
Du côté des parents dits « harkis » [catégorie amalgamant des situations extrêmement diverses] le silence s’origine également de la difficulté à donner une explication rationnelle à des choix qui n’ont généralement pas été maîtrisés. On ne rappellera jamais assez que la guerre d’Algérie a été une guerre totale, au sens où elle a impliqué l’ensemble de la population algérienne [et une partie essentielle de la population française]. Les familles, les confréries, les communautés villageoises ont été forcées de choisir en raison de la violence et de l’urgence des évènements. Dans ces conditions il est difficile de maîtriser tous les éléments d’un choix rationnel et conscient. Les familles se sont divisées selon les engagements, des frères se sont retrouvés dans des camps opposés sans que cela soit toujours pour des raisons politiques. Alors que dire aux enfants d’une décision que l’on n’a pas maîtrisée ou pas entièrement ? « Qu’est ce tu veux que je te raconte ? je ne sais pas moi-même ce qui s’est passé alors que veux-tu que je te raconte ? » répondait un père dit « harki » à son fils lors d’une interview croisée pour le livre suscité.
Le silence a été encore plus assourdissant au sein du reste de la société française, des décideurs politiques aux enseignants en passant par les médias et par l’ensemble des institutions. La crainte de voir se rouvrir des blessures tout juste cicatrisées, la peur de voir renaître des divisions du passé, la volonté d’occulter les pages les plus noires de la période coloniale, la culpabilité diffuse, la nostalgie d’empire, etc., tous ces facteurs se sont cumulés pour imposer un silence social, politique, médiatique et pédagogique. Un des effets notables de ce silence massif de la société française est de faire reposer sur les épaules individuelles la responsabilité du bilan. Pour de nombreuses personnes ayant été entraînés par contrainte dans cette sale guerre, l’impossibilité d’articuler leur bilan personnel à un bilan plus global collectif et à une parole publique est productrice d’un sentiment plus ou moins fort de culpabilité.
Adolescent dans le milieu des années 70, mes petits camarades et moi, avions appris à jouer de cette culpabilité. Dans l’insouciance adolescente nous la mettions à profit pour nous faire payer des boissons. Nous savions qu’en nous installant dans un café quelconque, nous serions interpellés par un client avec toujours cette même question : « Vous êtes d’où en Algérie ? ». La conversation engagée était l’occasion pour le client de parler de la beauté de l’Algérie, de la connerie de la guerre, du caractère contraint de sa participation à celle-ci, etc. Bien sûr dans d’autres occasions se sont des paroles de haines que nous avons croisées ou des regards fuyants. Dans les deux cas cependant l’absence de discours politique public laissait chacun de nos interlocuteurs seul face au bilan d’une colonisation et d’une guerre sur lesquelles le citoyen quelconque de ces époques avait peu de prise. Le besoin d’en parler avec des inconnus soulignait le poids pesant du silence collectif.
Le retour brusque du refoulé
Bien sûr adolescents nous savions quelque chose de la colonisation et de la guerre. Le silence n’avait pas été total et des bribes de l’expérience douloureuse des parents avait filtrées. Il ne s’agissait cependant que de bribes incapables de nous préparer à la découverte des horreurs de la colonisation et de la guerre. Chaque héritier de l’immigration algérienne a découvert de manière individuelle cette réalité, de manière plus ou moins brusque, plus ou moins violente. En ce qui me concerne c’est la réaction passionnée mais courte de mon père devant un auto-collant apposé sur mon cahier de texte pendant la campagne des présidentielles de 1974 qui marque un tournant. Comme tous les héritiers de l’immigration de mon âge du quartier, notre sympathie allait au candidat Mitterrand que nous estimions antiraciste et défendant les pauvres. A l’opposé se situait Le Pen qui était perçu comme l’incarnation du racisme. Quelle fut donc ma surprise en voyant mon père exiger que je retire l’auto-collant « d’un assassin et d’un tortionnaire » avant de retourner à son silence. Ce n’est que par des lectures à la bibliothèque municipale que j’ai pu donner un sens à la réaction de mon père. De manière plus ou moins précoce, plus ou moins accompagnée, plus ou moins préparée, chaque héritier de l’immigration algérienne a été confronté à cette irruption brusque d’une histoire refoulée.
Sur un plan collectif c’est l’arrivée sur le marché des biens rares (logements, emplois, loisirs, etc.) qui fait prendre conscience à toute une génération qu’elle n’est pas perçue comme française entièrement. La perception des discriminations et en premier lieu de la discrimination face au contrôle policier ancre progressivement une conscience de subir un traitement d’exception. Il en naîtra la marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983 qui marque ainsi l’arrivée à l’âge adulte de la première génération française héritière de l’immigration algérienne. Ces immigrés rappelant une histoire largement refoulée, que l’on croyait destinés à rentrer ont fait souche et ont engendrés des enfants qui exigent d’être traités à égalité des autres citoyens. Dans les débats multiples qui accompagnent la marche pour l’égalité et ceux des années suivantes la quête d’une explication sur l’origine du racisme et des discriminations dans la société française amène logiquement à croiser la question coloniale. La génération d’après a besoin pour se construire de rompre le silence prédominant jusque-là.
Cette rupture du silence collectif entre cependant en contradiction avec le modèle assimilationniste prédominant dans la société française. Au même moment en effet les « beurs » sont à la mode comme symbole vivant de l’assimilation. Ils sont médiatiquement mis en scène comme étant en rupture avec leurs parents, comme n’étant plus des « arabes ». Au moment où ils redécouvrent leurs propres parents [l’expérience coloniale que ceux-ci ont subis, les engagements qui ont été les leurs, le courage du combat nationaliste en pleine métropole, etc.], ils sont soumis à une injonction diffuse de distanciation. Sayad résume admirablement ce qu’il appelle une tentative de « chirurgie sociale » en évoquant le discours dominant sur les « beurs » :
Le « fossé entre les générations » n’est pas simplement l’effet différentiel, comme cela arrive ordinairement entre deux générations séparées dans le temps et séparées par des systèmes d’intérêts qui, tout en n’étant pas totalement identiques, ne divergent pas fondamentalement ; il est ici d’une autre nature, on le veut et on le fait d’une autre nature. Il est le fait d’un changement social qui résulterait d’une véritable opération de chirurgie sociale et d’une expérience de laboratoire. Aussi comprend-on l’intérêt objectif – intérêt qui s’ignore comme tel – qu’on a à distendre au maximum la relation entre, d’une part, des parents immigrés (…), et, d’autre part, les “enfants de parents immigrés” qui seraient alors, selon une représentation commode, sans passé, sans mémoire, sans histoire (…), et par là même vierges de tout, facilement modelables, acquis d’avance à toutes les entreprises assimilationnistes (…) mues par une espèce de “chauvinisme de l’universel[v]
∞ ∞ ∞
La colonisation de l’Algérie a profondément modifié et marqué tant la société algérienne que la société française. Si les travaux sur l’impact de la colonisation sur l’Algérie et son peuple commencent à être conséquents, ceux sur l’impact sur la France et son peuple restent plus que parcellaires. Elle est pourtant productrice d’un trauma collectif reproduit par le silence de l’ensemble des acteurs de l’hexagone ayant vécus cette séquence historique ou en ayant hérités. Le besoin de combler cette lacune et de briser le silence ne renvoie pas à une fascination morbide ou à une exigence moralisante de repentance. Il est au contraire une condition de possibilité de dépassement collectif d’une séquence traumatisante d’une part et de décolonisation cette fois-ci non plus de l’Algérie mais de l’hexagone d’autre part. Faute de ce travail les fantômes du passé continueront à hanter le présent et à le façonner pour la longue durée.
Saïd Bouamama
[i] Saïd Bouamama, Les héritiers involontaires de la guerre d’Algérie, Editions du CREOPS, Manosque, 2003.
[ii] Abdelmalek Sayad, Une immigration exemplaire, in La Double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Seuil, Paris, 1999, p. 103.
[iii] Kamel Kateb, Européens, « indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962) : représentations et réalités des populations, INED/PUF, Paris, 2001, p. 47.[iv] Saïd Bouamama, Les héritiers involontaires de la guerre d’Algérie, op. cit., p. 39.
[v] Abdelmalek Sayad, Le mode de génération des générations immigrées, Migrants-formation, n° 98, septembre 1994, p. 14.
October 26, 2022
Néo-colonialisme, capitalisme et racisme : un complexe systémique indissociable
Cet article a été publié dans la revue du CETIM « Lendemains Solidaires », N° 2, 19 mai 2022, https://lendemainssolidaires.org/neo-colonialisme-capitalisme-et-racisme-un-complexe-systemique-indissociable/
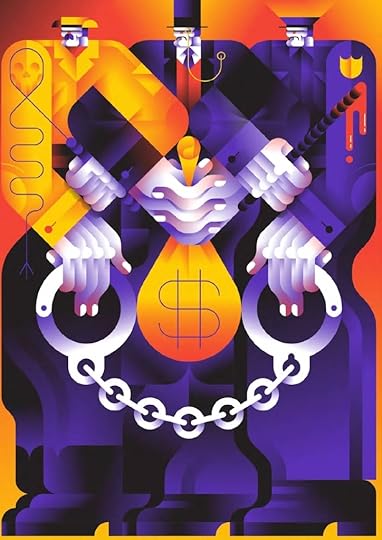
Le racisme n’est pas une « essence » ou un simple trait pervers de l’humanité. Il est le produit de conditions historiques déterminées dans le sillage du colonialisme et du capitalisme.
Depuis l’expérience du nazisme, le racisme comme idéologie justifiant une hiérarchisation de l’humanité, est marqué du sceau de l’illégitimité. Avant elle, le racisme avait droit au chapitre dans les universités et la recherche scientifique d’une part, le champ politique et médiatique d’autre part et le corpus juridique pour une troisième part. Comme le soulignait Aimé Césaire dès 1950, il a fallu que les horreurs subies jusque-là par les esclaves et les colonisé·es soient infligées à des « blancs » par d’autres « blancs » pour qu’enfin le racisme cesse d’être considéré comme une opinion légitime1. Dans l’euphorie de la victoire contre la « bête immonde », beaucoup annonçaient la fin du racisme. Ce ne fut pas le cas. Pour quelles raisons ?
L’angle mort des explications dominantes du racismeIl est fréquent d’entendre des explications du racisme le posant comme réalité ayant existé depuis les débuts de l’humanité. Il serait en quelque sorte une « malédiction » de l’humanité, un trait permanent de celle-ci. Une telle approche n’est possible qu’en amalgamant des réalités sociales différentes afin d’en conclure à l’existence d’un invariant raciste. Plus précisément, l’amalgame entre l’ethnocentrisme et le racisme est au cœur d’une telle approche. Comme le souligne Claude Lévi-Strauss, l’ethnocentrisme est un des traits quasi-universels des groupes humains2. Cet « orgueil de groupe » ou cette « préférence pour mon groupe » ne saurait cependant se confondre avec le racisme posant l’existence de races, leur hiérarchisation et la légitimité de la domination de certaines de ces races sur d’autres. L’amalgame empêche ainsi de comprendre les conditions historiques ayant fait émerger le racisme d’une part et les fonctions qu’il remplit d’autre part. En posant le racisme comme « essence » de l’humanité, les explications dominantes portent ainsi un angle mort lourd d’enjeux.
La consubstantialité économique du capitalisme et du colonialismeLa colonisation des « Amériques », la mise en esclavage des peuples indigènes puis la traite transatlantique et enfin la colonisation bornent l’époque des théorisations racistes. Celles-ci apparaissent historiquement de manière contemporaine au capitalisme et au colonialisme. « Les relations raciales, les antagonismes raciaux, les groupes raciaux et le racisme […] sont liés aux situations esclavagistes et post-esclavagistes, coloniales et postcoloniales, telles qu’elles se sont établies à partir de l’expansion européenne »3explique le sociologue Pierre Jean-Simon. Non seulement le racisme n’a pas toujours existé, mais il peut se dater assez précisément de 1492, complète cet auteur après de nombreux autres4. Le racisme est pour cette école assis sur des conditions économiques inédites dans l’histoire de l’humanité ayant engendré simultanément un mode de production économique spécifique, le capitalisme et une tendance à l’extension de celui-ci à l’ensemble de l’humanité par la force brutale.
En posant le racisme comme « essence » de l’humanité, les explications dominantes portent ainsi un angle mort lourd d’enjeux.
Le passage d’une société marchande à une société capitaliste a été historiquement rendu possible par l’afflux de richesses provenant de la destruction des civilisations indigènes des « Amériques » puis par la traite transatlantique. Il n’y a donc pas eu naissance du capitalisme puis du colonialisme, mais un seul processus dans lequel le colonialisme fournit une part essentielle de l’accumulation primitive du capitalisme et dans lequel ce dernier suscite une colonisation grandissante du globe. Avant l’apparition du capitalisme, plusieurs sociétés ont connu des développements poussés de rapports marchands sans que ceux-ci ne débouchent sur des rapports capitalistes (Chine, Afrique du Nord, etc.). Il y a en quelque sorte une consubstantialité économique du capitalisme et du colonialisme – les formes de celui-ci pouvant bien sûr varier. C’est cette première consubstantialité qui en explique une seconde.
La consubstantialité idéologique du colonialisme, du capitalisme et du racismeAu moment où se réalise l’expansion brutale européenne, celle-ci ne peut se déployer qu’en justifiant idéologiquement l’asservissement violent d’une partie de l’humanité. Ce besoin de justification concerne à la fois les peuples des pays colonisateurs et ceux des pays colonisés. Aux uns, il faut inculquer un « sentiment de supériorité » et aux autres, il faut inculquer un « sentiment d’infériorité ». Les théorisations racistes sont une réponse à ce besoin de légitimation. Il n’y a donc pas eu d’une part naissance du capitalisme, d’autre part, développement du colonialisme et pour une troisième part, théorisation du racisme mais un seul processus global à la fois économique, militaire et idéologique. Mais l’histoire ne s’arrête pas à ce capitalisme infantile en expansion coloniale immédiate argumenté par un « racisme biologique ».
L’expérience du nazisme, les nouveaux rapports de forces à l’issue de la Seconde Guerre mondiale et la révolte des colonisé·es ont rendu obsolètes à la fois le « colonialisme direct » et le « racisme biologique » comme idéologie de justification. Pour survivre, l’ensemble du système de domination doit muter dans l’ensemble de ses dimensions (économique, militaire, idéologique). Le second âge du capitalisme s’accompagne non plus du « racisme biologique » mais, d’un « racisme culturaliste » posant certaines cultures supérieures à d’autres tout en affirmant l’inexistence des « races ». Dans le même mouvement, le colonialisme abandonne ses formes anciennes de colonisations directes pour des formes néocoloniales plus invisibles. Ladite « mondialisation » de la fin du siècle dernier exige à son tour un reformatage de l’ensemble du système de domination pour mieux se maintenir. Le néocolonialisme prend une forme « mondialisée », le racisme culturaliste se rénove dans des approches en termes de civilisations antagonistes et le capitalisme s’affiche comme transnational. Ces mutations historiques simultanées du capitalisme, du colonialisme et du racisme ne peuvent pas cacher la similitude de fonction idéologique du racisme à toutes les époques : empêcher les solidarités entre les peuples d’ici et de là-bas par la diffusion de clivages « ethniques » en lieu et place des clivages économiques et des luttes des classes qui en découlent. Il s’agit ni plus ni moins que de diviser ceux qui devraient être unis [les peuples d’ici et de là-bas] et d’unir les classes sociales ayant des intérêts divergents ou encore d’empêcher le développement d’un internationalisme des dominé·es.
1 Aimé CESAIRE, Discours sur le colonialisme (1950), Présence africaine, Paris, 1955.
2. Claude LEVI-STRAUSS, Race et Histoire, Unesco, Paris, 1973.b
3 Pierre-Jean SIMON, Les rapatriés d’Indochine : un village franco-indochinois en Bourbonnai, L’Harmattan, Paris, 1981, p. 19.
4 Précisément la date du 11 octobre 1492 – arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes – ouvrant le cycle de conquête brutale et de colonisation du continent américain, voir Pierre-Jean SIMON, Ethnisme et racisme ou « l’école de 1492 », Cahiers Internationaux de sociologie, volume 48, janvier-juin 1970, pp. 119-152.
April 22, 2022
La place des classes et quartiers populaires dans le processus de fascisation
Article paru dans la revue d’Attac « Les Possibles » le 14 avril 2022
L’emprunt par de nombreux candidats et par une partie conséquente des champs médiatique et politique de concepts et de raisonnements empruntés à l’approche culturaliste (séparatisme, crise de l’identité, etc.) en lieu et place de l’approche économique et sociale, qui était prédominante depuis la victoire contre le nazisme, conforte encore ce bilan. Après avoir apporté quelques précisions sur les notions de fascisation, d’extrême droite, de classes populaires et de quartiers populaires trop souvent utilisées sans précision, nous nous pencherons sur la place des classes et quartiers populaires dans la rhétorique fascisante et sur les conséquences du contexte idéologique actuel sur les membres de ces classes et sur les habitants de ces quartiers.
 Les mots sont importants
Les mots sont importantsNous appelons fascisation le processus d’enracinement multiforme de la logique fasciste se déployant dans une société non dirigée par un pouvoir politique fasciste et continuant à fonctionner en se légitimant d’un cadre démocratique. À l’exception des venues au pouvoir de fascistes par un coup d’État brusque (et encore de nombreux signes sont repérables même dans ces situations), toutes les expériences fascistes que nous avons connues historiquement ont été précédées d’un processus plus ou moins long de fascisation. La fascisation n’est en conséquence pas réductible à l’action des groupes explicitement fascistes. Elle est le fait à la fois de ceux-ci et d’autres acteurs politiques (d’autres partis, de l’appareil d’État, du pouvoir politique, etc.). Résultat du rapport des forces social et idéologique, le processus de fascisation se déploie au moins à trois niveaux : le niveau idéologique par la diffusion de concepts, de théories et de thématiques. Le niveau culturel par la banalisation de représentations sociales culturalistes. Et enfin le niveau pratique par des passages à l’acte d’une part et par des mesures légales découlant logiquement des deux niveaux précédents mais également de la tentative du pouvoir politique de sortir d’une crise de légitimité d’autre part. Progression quantitative de ladite extrême droite, banalisation de ses thèmes et de son vocabulaire, crise de légitimité profonde (dont l’abstention et les Gilets Jaunes ne sont que les indices les plus visibles), ces trois constats permettent de conclure que nous sommes en France dans une séquence de fascisation.
Les termes « d’extrême droite » ou de « populiste » eux-mêmes font parties intégrantes de la dynamique régressive en cours. Ils euphémisent la nature des groupes et partis politiques ainsi dénommés et contribuent à invisibiliser leur matrice idéologique fasciste. Que ce soit historiquement ou présentement le fascisme n’est pas une réalité homogène. Il prend des formes variables historiquement et nationalement. Il se diversifie pour s’ancrer dans une société en s’adaptant à son histoire, à ses héritages, à ses peurs, à ses préoccupations populaires. Appeler d’« extrême droite et/ou « populistes » Marine Le Pen ou Éric Zemmour a, selon nous, contribué à la production du contexte actuel.
Le troisième élément de précision concerne les concepts de classes et quartiers populaires. La doctrine fasciste se centre soit sur une négation de l’existence des classes sociales, soit sur une vision organiciste posant ces classes comme complémentaires. Son axe central est celui de « nation » et/ou de « peuple », considérés comme une entité organique à laquelle contribuent de manière harmonieuse les différentes classes sociales. Les classes populaires que nous entendons comme constituées de la classe ouvrière et des couches moyennes sont dans l’optique fasciste abordées comme cible pour qu’elles ne se tournent pas vers la « lutte des classes » dans les séquences historiques marquées par une accélération rapide de la paupérisation, de la précarisation et du déclassement.
Enfin, le concept de quartiers populaires est une expression apparue dans les dynamiques militantes pour rendre compte de la partie la plus précarisée de la classe ouvrière (précariat, immigration et héritiers de l’immigration, etc.), pour laquelle la précarité et l’incertitude dans le rapport à l’entreprise font de l’espace d’habitation un axe premier de socialisation. La définition identitaire de la nation de la logique fasciste élimine les habitants de ces quartiers du « peuple » d’une part, les construit comme « étrangers » à la « nation » (non pas seulement juridiquement mais d’abord identitairement) d’autre part, et les utilise comme « bouc émissaire » symbole d’une « anti-France » et source de toutes les difficultés sociales des « classes populaires » et de la « nation » pour une troisième part. C’est pourquoi nous décidons d’utiliser ce concept afin de souligner en permanence l’appartenance au peuple et à la nation de ces périphéries de la République.
La définition identitaire de la nationPour simplifier disons que les positions politiques qui se sont affrontées dans l’histoire et qui s’affrontent encore aujourd’hui sont sur les questions de l’identité et de la nation situées entre deux pôles. Le premier est constitué d’une définition sociale et historique de l’identité et de la nation posant celles-ci comme une production historique et sociale marquée par le mouvement et les interactions et reflétant les mutations du peuplement du territoire hexagonal. À l’opposé se situe la définition fasciste de la nation et de l’identité posant celles-ci comme une « essence nationale » se déployant dans l’histoire et faisant de cette histoire celle du déroulement de cette « essence », du combat pour la préservation de la pureté de cette « essence » ou pour le renouement avec elle postulé comme remède à toutes les difficultés économiques et sociales subies par les citoyens. Entre les deux se trouvent une diversité de définitions mixtes, reflets des rapports de force entre les deux pôles extrêmes précédents.
Dans la logique fasciste l’immigration et ses héritiers français ne peuvent être perçus que comme corps extérieurs menaçant la pureté de l’essence qu’il s’agit de préserver. Les termes de « grand remplacement » et de « séparatisme » ne sont que l’actualisation de cette antienne fasciste. Dans cette logique, l’avenir proposé à cette partie du « peuple » est au mieux l’assimilation et au pire l’expulsion et/ou un statut d’ennemi de l’intérieur à réprimer. Le retour dans la campagne présidentielle du concept de « Français de papier » (s’opposant aux « vrais Français ») est sur cet aspect significatif.
En termes de conséquences, la montée significative en puissance de la définition fasciste de la nation ces dernières décennies se traduit en premier lieu par une « charge mentale » considérable. Sans cesse au cœur des polémiques politiques et continuellement construites politiquement et médiatiquement comme problème et comme menace, nos concitoyens immigrés ou français héritiers de l’immigration voient leur quotidienneté mise en permanence sous tension. La seconde conséquence est la production d’une « peur sociale » à l’égard de cette partie de notre peuple. Le « racisme d’en haut » (que Pierre Bourdieu appelait le « racisme de l’intelligence ») finit à la longue par imbiber une partie grandissante de la société et suscite de ce fait un « racisme d’en bas » aux effets multiples : hausse des discriminations racistes, passages à l’acte verbaux ou physiques également en augmentation, signaux d’indésirabilité dans certains espaces (centres-villes, lieux de loisirs ou de vacances, territoire d’habitation lors de la recherche de logement, etc.). Une troisième série de conséquence découle des deux précédentes. Elle consiste en la diminution du champ des possibles de cette partie de notre peuple conduisant une part de celle-ci à restreindre ses interactions sociales à l’extérieur du quartier par souci de protection, par fuite de l’interaction raciste possible et/ou de l’humiliation crainte, par besoin d’un minimum de calme et de sérénité, etc. Ces postures qui sont des conséquences sont à leur tour réintégrées dans la logique culturaliste comme étant des causes confirmant que cette partie du peuple est au moins un problème et au pire une menace. Enfin une dernière série de conséquences se situe dans le processus largement documenté de « retournement du stigmate » : une partie de ces concitoyens brandissant les stigmates diffusés médiatiquement et politiquement comme étendard à des fins de préservation de l’image de soi et de sauvegarde de la dignité. Autrement dit, le contexte de fascisation actuel n’est pas seulement un danger pour l’avenir mais est d’ores et déjà producteur d’effets négatifs sur la santé physique et mentale des habitants des quartiers populaires, sur les projections dans le futur et les projets de vie, sur le rapport à soi, aux autres et à la société, etc.
Producteurs contre « assistés »Le premier niveau de définition de la nation est complété par un second renvoyant cette fois-ci à la dimension sociale de l’identité. Opposée à l’idée qu’il existe un antagonisme de classes, la doctrine fasciste explique la paupérisation, la précarisation et le déclassement qui touchent les classes populaires par une logique morale opposant de bons citoyens producteurs (et contribuant de ce fait à la grandeur de la nation) et d’autres mauvais citoyens caractérisés par le parasitisme et l’assistanat. Bien sûr, les immigrés et leurs héritiers français sont construits comme la figure première de ces « assistés ». Le discours sur la préférence nationale s’inscrit ici comme première étape d’une logique plus large visant à détruire les politiques sociales et les services publics obtenus par les combats sociaux du passé. La proposition de Macron visant à imposer une charge de travail pour les bénéficiaires du RSA s’inscrit dans la même logique. Politique néolibérale et fascisation ne sont pas séparables. Les deux contribuent à faire basculer notre société dans la direction de la disparition des fonctions sociales de l’État, dans le sens du remplacement de la solidarité nationale par la charité, dans l’orientation de la remise au travail à bas coût du maximum de force de travail.
En termes de conséquences, ce second niveau de définition de la nation opposant bons et mauvais citoyens, se traduit par la tendance à l’opposition entre « assistés » habilement entretenue tactiquement par la thématique de la « préférence nationale » avant de pouvoir s’étendre sans limite à tous. Nous avons dans d’autres écrits résumé cette conséquence par la formule suivante : « diviser ceux qui devraient être unis et unir ceux qui devraient être divisés ». Autrement dit, il s’agit ni plus ni moins que de masquer le clivage de classes réellement existant en suscitant un clivage ethnique et/ou un clivage entre « producteurs » et « assistés ». Une seconde conséquence touche, selon nous, à la posture politique pour les « assistés » promue par ces clivages idéologiques. La posture du citoyen légitimement porteur de droits sociaux est remplacée par celle du citoyen en difficulté devant culpabiliser en ce qui concerne ses difficultés sociales et devant se satisfaire de l’aumône publique et privée. Sur cet aspect également, les effets sont d’ores et déjà en œuvre dans nos quartiers populaires. Le repli sur soi et le renoncement à une vie sociale, l’acceptation par contrainte de postes et de conditions de travail inimaginables il y a encore quelques décennies, le renoncement par honte à certains droits, l’exacerbation de la violence de proximité à l’égard des voisins, etc., sont autant de résultats déjà en œuvre dans ces espaces de relégation.
La banalisation d’un contrôle policier d’exceptionConstruire politiquement et médiatiquement l’immigration et ses héritiers français d’une part et les quartiers populaires d’autre part comme problème et comme menace ne pouvait que déboucher logiquement sur des pratiques de surveillance spécifiques de cette partie de la population et de ces territoires. Le discours explicatif du réel social ne peut être crédible que s’il est associé à des pratiques idoines indiquant à des fins de légitimité politique la volonté de prendre à bras le corps les « problèmes » mis en scène. Le segment descendant de fascisation initié par le pouvoir politique (de Sarkozy et son Karcher à Macron et son séparatisme) s’est, bien entendu, encore amplifié, par la logique de surenchère de la droite et de la galaxie fasciste (qui constituent un second segment ascendant, celui-ci de fascisation) et a trouvé dans le contexte des attentats un terrain de légitimation quasiment sans opposition. Concrètement, cela s’est traduit dans les quartiers populaires par une banalisation du contrôle policier au faciès, par la création de corps de police spécifiques (dont la BAC n’est que l’exemple le plus connu) dédiés à ces quartiers et à leurs habitants, à la généralisation de méthodes prenant pour cible tout un territoire (opérations coup de poing par exemple), à la militarisation de l’armement des policiers intervenant dans ces espaces, à des pratiques d’humiliation atteignant fortement ceux qui les subissent, etc. Certes, il y a toujours eu une surveillance particulière des « classes dangereuses » mais ces dernières décennies de fascisation ont conduit à une véritable territorialisation des politiques policières instituant un rapport d’exception à certains territoires. Il n’est qu’à regarder la liste et les lieux dans lesquels cette interaction spécifique avec l’institution policière a conduit à des morts de jeunes pour se rendre en compte de l’ampleur des effets de cette territorialisation. Le sentiment de découverte de la violence policière au moment des luttes des Gilets Jaunes et du mouvement contre la réforme des retraites souligne l’ampleur de la coupure qui s’est installée entre le monde militant et cette partie de notre peuple. « Les Gilets Jaunes découvrent ce que nous subissons depuis des décennies » disait-on alors dans les quartiers populaires.
Bien entendu les habitants des quartiers populaires ne restent pas inactifs face à ce traitement d’exception comme face aux autres conséquences de la fascisation que nous avons décrites plus haut. Si les quartiers populaires sont le lieu d’une dégradation réelle des rapports sociaux de proximité, ils sont également l’espace où la solidarité continue de se déployer le plus fortement et où la dynamique associative et revendicative formelle ou informelle subsiste et se renouvelle. Si les pratiques policières d’exception se sont banalisées, elles continuent à rencontrer une résistance multiforme, individuellement et collectivement, organisée ou spontanée, durable ou momentanée. C’est à ce niveau qu’intervient un autre pan du processus de fascisation descendant, c’est-à-dire porté par le pouvoir politique, celui de la silenciation des voix discordantes. La multiplication des dissolutions d’associations accusées d’être des vecteurs du « terrorisme », du « séparatisme », de la « haine », de « l’antisémitisme », etc., n’est que la partie visible de l’iceberg de cette logique de silenciation. Par de nombreux autres moyens une répression moins visible s’est banalisée au cours de ces dernières décennies. Diabolisation des leaders, suppression de subventions, entraves à l’accès aux salles et équipements publics, etc., autant de moyens aboutissant à l’impossibilité d’exercer dans les quartiers populaires des droits pourtant légalement reconnus. Sur ces aspects également les dangers dans les quartiers populaires ne sont pas à venir mais bien présents actuellement.
L’isolement politique organiséUne telle silenciation de la colère populaire dans ces territoires d’habitation a bien sûr de nombreuses conséquences. Une colère qui ne peut s’exprimer politiquement et collectivement ne disparaît pas pour autant mais au contraire prend d’autres canaux d’expression. Les pratiques d’autodestructions, les attitudes nihilistes, le retournement de la colère sur les proches dans la famille ou le voisinage, etc., sont, selon nous, des conséquences de cette silenciation d’autant plus destructrice qu’est grand le sentiment de relégation, d’injustice, de mépris social, etc. C’est à ce niveau que se déploie un autre effet du processus de fascisation qui n’est rien d’autre que l’organisation de l’isolement politique des quartiers populaires. La campagne sur « l’islamo-gauchisme » a été la forme la plus visible de cette organisation de l’isolement politique. Le « contrat d’engagement républicain » en est la forme banalisée au niveau légal. Les deux révèlent une tendance au maccarthysme politique ayant pour objectif, non sans succès, de développer une autocensure interdisant certains termes (islamophobie, racisme d’État, violences policières, etc.), certaines grilles de lecture, certaines pratiques (réunions non mixtes par exemple).
Les dissolutions, silenciations à bas bruit et la logique maccarthyste de la campagne sur l’islamo-gauchisme ont été initiées par le pouvoir politique légalement élu. Elles s’inscrivent néanmoins elles aussi dans un contexte de surenchère porté par la droite et la galaxie fasciste. Le résultat en est une situation comparable à une « boite de Pandore » où chaque palier franchi en appelle un nouveau plus répressif, plus attentatoire aux libertés démocratiques et aux droits. Sur cet aspect également les segments descendant et ascendant du processus de fascisation s’entretiennent l’un l’autre. C’est ainsi également que grandissent le sentiment d’isolement politique dans les quartiers populaires et avec lui une tendance à la massification de l’abstention électorale. À son tour cette abstention durable et en augmentation est rentable électoralement pour certaines forces politiques et en éloigne d’autres des préoccupations des habitants de ces quartiers populaires et les oriente vers d’autres électorats moins abstentionnistes.
Dans les quartiers populaires, les effets du processus de fascisation ne sont pas seulement à venir, mais bien installés déjà depuis plusieurs décennies. Ils ont un impact palpable sur la quotidienneté des habitants de ces territoires et des effets tout aussi importants sur leur santé physique et mentale, sur leurs rapports sociaux et sur les formes disponibles d’expression de leur colère sociale. Le poncif médiatique et politique présentant la montée de l’extrême droite comme résultat d’une demande politique populaire d’autoritarisme, de racisme et de sécurité masque la nécessaire prise en compte des liens entre « racisme d’en bas » et « racisme d’en haut » et l’ordre des causes et des conséquences de ces deux racismes. Contrairement à ce poncif, ce n’est pas le « racisme d’en bas » qui a suscité un « racisme d’en haut » mais fondamentalement l’inverse.
Saïd Bouamama's Blog
- Saïd Bouamama's profile
- 6 followers



